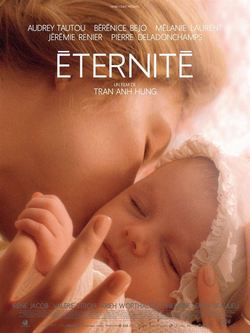-
Délicieusement kitch et délicieux. Même si la fin est prévisible, c'est une comédie sentimentale très réussie. Les années 50' avec la déco, la mode etc... sont très bien décrites. Original et amusant. J'ai bien aimé malgré l'absence de surprises.
scénario: 17/20 acteurs: 18/20 technique: 17/20 note finale: 17/20

Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar d’un petit village normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard, 36 ans, patron charismatique d’un cabinet d’assurance, cherche une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune femme réveille malgré elle le sportif ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle devra participer à des concours de vitesse dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet, il s’improvise entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du sport ne fait pas forcément bon ménage avec l’amour tout court…
On pourrait ne voir en Rose Pamphyle (Déborah François) qu’une jolie potiche ; le genre de fille naïve capable de se laisser embobiner par le premier venu ; une bouille de gamine et des rêves de midinette qu’elle accroche au dessus de son lit… Une fille qui, se rêvant aux bras d’un Clark Gable, se retrouverait finalement mariée au fils du garagiste de son village natal, le gentil garçon ni vraiment beau mais pas laid non plus avec qui elle jouait au docteur quand elle était petite.
Oui, il y a bien un peu de tout cela dans la personne de Rose Pamphyle. Et ses rêves d’émancipation n’atteignent pas des sommets d’ambition : elle pourrait vouloir être chanteuse (en même temps, il est vrai, en cette année 1958 la Star’Ac n’a pas encore sévi), comédienne, voire aventurière, mais non, elle veut juste être secrétaire. Un métier « moderne », un métier d’avenir, un métier qui lui donnera la chance de quitter l’épicerie familiale, de ne pas se marier, de ne pas devenir femme et puis mère au foyer.
Alors voilà, quand elle apprend que le cabinet d’assurance « Echard et fils », à Lisieux, est à la recherche d’une secrétaire, elle est prête à tout pour décrocher le poste. Elle va y aller au flanc, au culot, à l’audace, avec malice et espièglerie, mais oui, exactement comme dans la chanson de la Candy de notre enfance. Est-ce précisément par la grâce de sa candeur, de sa maladresse, de sa fraîcheur ou simplement parce que Rose fait un peu tache au milieu des autres prétendantes au poste, tirées à quatre épingles, pomponnées comme des caniches à un concours de beauté, toujours est-il que Louis Echard (Romain Duris), le patron de cette petite entreprise familiale à la papa, va l’embaucher. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est que la pétillante, la fougueuse, la pétaradante Rose a un petit don : elle tape à la machine aussi vite que Gary Cooper dégaine dans L’Homme de l’Ouest.
Comme c’est un vrai macho (qui ne s’avoue pas l’être, comme tous les vrais machos) et qu’il a le sens de la compétition, Louis va inscrire Rose à un concours de vitesse dactylographique, discipline qui sévissait dans les années 50, obnubilée par records de rapidité en tout genre. Et comme Rose a le sens du défi, elle va se lancer dans l’aventure tête baissée. La voici donc coachée comme un Rocky Balboa avant l’affrontement sur le ring… autant dire que ça va saigner entre les championnes de la frappe à la machine !
Comédie forcément romantique, Populaire est un hommage à celles des années 50, américaines en particulier, et les clins d’œil aux films de cette époque sont légion. Rose Pamphyle n’est pas sans rappeler certains des personnages d’ingénue maladroites, inconscientes de leur sex-appeal qu’interprétait Marilyn Monrœ dans Les Hommes préfèrent les blondes ou Comment épouser un milliardaire. Sous ses airs de fille simple, Rose cache finalement un vrai esprit frondeur, et même si elle finira par s’enfermer dans un autre carcan, certes plus brillant que celui auquel elle s’était promis d’échapper, elle est aussi l’incarnation de la révolution féminine qui allait bouleverser cette période charnière du début des années 60… A l’instar du personnage principal d’un roman court de cette même époque, Roses à crédit d’Elsa Triolet, qu’on ne saurait trop vous inviter à lire, si ce n’est déjà fait… 1 commentaire
1 commentaire
-
Un très joli road movie sur l'amitié entre hommes. le jeu des acteurs est tout en nuances et en sensibilité. Trés réussi.
scénario: 17/20 acteurs: 17/20 technique: 17/20 note finale: 17/20

Depuis que Charlie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces trois hommes que tout sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur sœur, la femme de leur vie ou leur pote, c’était selon. Sauf que Charlie est morte et que ça, ni Boris, homme d’affaires accompli, ni Elie, scénariste noctambule et ni Maxime, 20 ans toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire face. Mais parce qu’elle le leur avait demandé, ils décident sur un coup de tête de faire ce voyage ensemble, direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement voilà, 900 kilomètres coincés dans une voiture quand on a pour seul point commun un attachement pour la même femme, c’est long… Boris, Elie et Maxime, trois hommes, trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée, la certitude que Charlie a changé leur vie pour toujours.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Vous savez pourquoi ce film fait un gros bide? parce que c'est un GROS navet!! Sans queue ni tête, ce navet est d'un ennui mortel. C'est peu de dire que c'est ennuyeux.
scénario: 02/20 technique: 10/20 acteurs: 5/20 note finale: 1/20

Région parisienne, début des années 70.
Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’effervescence politique et créatrice de son temps. Comme ses camarades, il est tiraillé entre un engagement radical et des aspirations plus personnelles.
De rencontres amoureuses en découvertes artistiques, qui les conduiront en Italie, puis jusqu’à Londres, Gilles et ses amis vont devoir faire des choix décisifs pour trouver leur place dans une époque tumultueuse.Avec Après Mai, Olivier Assayas nous offre une belle fresque autobiographique, qui nous promène de France en Italie et à Londres, et qui fait revivre avec beaucoup de justesse et d'intelligence le temps de son adolescence : celui des années 70. Période foisonnante qu'il avait déjà abordée dans L'Eau froide (1994) et dans son récent Carlos. « Ce n'est plus le moment authentiquement révolutionnaire de Mai 68, dit le réalisateur, mais son sillage. » Le fond de l'air est rouge, et le petit groupe de terminales d'un lycée de banlieue suivi par Assayas est ultra-politisé. La jeunesse d'aujourd'hui a sans doute du mal à imaginer ce mélange détonant d'idéologie confuse et d'action fébrile, distribution de tracts, coopération à la presse militante gauchiste, manifs, tentatives désordonnées de coordonner des groupuscules ou de se greffer sur des occupations d'usine. « L'obsession de la politique était partout, se souvient Assayas, elle formait une espèce de sur-moi qui pouvait être étouffant. Il y a quelque chose de violent et de triste dans le gauchisme. Mais en même temps, la jeunesse avait foi dans le futur, dans la transformation possible de la société. Est-ce dépassé aujourd'hui ? Aux jeunes de se poser la question, de confronter leur jeunesse à la nôtre. »
Le film commence en 1971, avec un fait réel et violent : la manifestation interdite en faveur de leaders de la Gauche Prolétarienne emprisonnés, spectaculairement réprimée par des CRS à moto. Sans transition, on se retrouve dans un cours de philo avec une citation de Pascal : « Entre nous et le ciel, l'enfer et le néant, il n'y a donc que la vie, qui est la chose du monde la plus fragile. » C'est cette chose fragile que met en scène Olivier Assayas, feu et flamme de la jeunesse qui voudrait embraser le monde, mais qui cherche son souffle, s'éteint parfois. En même temps qu'une peinture de l'époque, Après Mai est un film d'apprentissage, où les personnages cherchent leur chemin personnel à travers l'engagement politique certes, mais aussi les sentiments amoureux, les études et le choix d'un métier.
Gilles (Clément Métayer) est le plus proche d'Olivier Assayas. Il peint, il dessine, bientôt il deviendra cinéaste. Il baigne dans la contre-culture musicale et politique du temps, qui l'oppose à son père, scénariste et réalisateur de la télévision « bourgeoise ». Mais le fait qu'il vienne d'un milieu cultivé, et qu'il ait une vocation artistique, lui donne des outils de réflexion critique sur l'embrigadement politique et le militantisme. Il lit Les Habits neufs du président Mao de Simon Leys, premier et impitoyable dénonciateur du maoïsme, qu'un de ses copains gauchistes censurerait volontiers : un agent de la CIA, dissimulé sous un faux nom. Mais surtout, Gilles est d'abord artiste, ce qui signifie aller vers la solitude plutôt que vers la multitude, écouter ses voix intérieures plutôt que des mots d'ordre.
Cette distance critique, qui est celle du cinéaste autant que du personnage, jointe à une connaissance précise des codes et des comportements de la contre-culture, donne à Après Mai une exactitude historique et une lucidité intime très remarquables. On voit vraiment surgir une génération. « Aujourd'hui, dit Assayas, on a tendance à représenter une adolescence rigolarde, allant de fête en drague. Ce n'est pas le sentiment que j'ai gardé de la mienne, où l'amour de la vie s'alliait à la mélancolie et au sérieux. » votre commentaire
votre commentaire
-
Si l'idée du réalisateur c'était de nous faire ressentir l'ennui de Thérèse, c'est complètement réussi. malgré une image magnifique, des décors et des costumes magnifiques, on s'ennuie ferme. Je n'ai pas lu le livre mais s'il est aussi chiant que le film...
scénario: 15/20 technique: 20/20 acteurs: 18/20 note finale: 14/20

Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles. Thérèse Larroque devient Madame Desqueyroux ; mais cette jeune femme aux idées avant-gardistes ne respecte pas les conventions ancrées dans la région. Pour se libérer du destin qu’on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie…
C’est l’ultime film de Claude Miller, emporté par un cancer en avril dernier. Faut-il pour autant y déceler une gravité supplémentaire, une dimension « testamentaire » comme on peut souvent le lire lorsque les cinéastes ont disparu alors que leur œuvres sont livrées au public : non. C’est un film qui trouve tout naturellement sa place dans la filmographie du réalisateur de L’effrontée ou de La classe de neige et l’on y rencontre cette tonalité si particulière propre à la plupart de ses films, sans doute ici exacerbée car reposant sur le très beau texte de François Mauriac : une ambiance un peu étouffante, des personnages complexes qui semblent ne jamais se résoudre à épouser la typologie dans laquelle on voudrait les enfermer. Thérèse Desqueyroux n’est pas tout à fait la jeune femme avant-gardiste que l’on imagine et Bernard, son époux, n’est pas uniquement le grand propriétaire terrien un peu bêta que l’on pourrait croire. Les choses sont plus compliquées qu’elles n’en ont l’air et tout le récit se construira autour de ce précepte, distillant par ailleurs un venin pernicieux : mensonges et faux semblants règnent en maître, s’attachant à sauver les apparences d’un petit milieu bourgeois provincial encore convaincu de sa supériorité.
Ici dans les Landes, au cœur d’un paysage splendide entre océan et forêt, on arrange les mariages pour réunir les terres et allier les familles. Cette pratique ancestrale permet de bâtir des empires sur lesquels s’érigent des fortunes familiales, commerçant là le vin, ici le bois. Thérèse Laroque va ainsi épouser le fils Desqueyroux : une alliance prometteuse qui viendra asseoir l’hégémonie du clan sur la région. L’amour n’a pas vraiment sa place dans cette transaction, l’amour viendra sans doute à l’usage, à force d’habitude, ou bien il ne viendra pas et on fera comme si. Quand elle épouse Bernard, Thérèse a des idées plein la tête, des idées qui ne semblent pas devoir s’accorder avec le monde qui l’entoure, des idées bouillonnantes qui la troublent, l’émeuvent, la distraient… Homme radical et avant-gardiste, son père y est sans doute pour quelque chose, et ce n’est sans doute pas non plus un hasard si le nouveau fiancé est son exact opposé.
Refouler ses idées folles, ses rêves d’envol, enfouir ses désirs et ses curiosités sous le sable étouffant des conventions et espérer que tout disparaisse à jamais : voilà l’objectif qu’elle se fixe, comme un défi personnel, à la veille des noces. Mais le mariage ne sied pas vraiment à Thérèse et l’homme dont elle partage l’existence et les hectares de pins est un individu étriqué, aux préoccupations basiques, un homme qui ne lui inspire ni désir, ni exaltation, ni attirance sensuelle, tout au plus une vague affection, celle que l’on peut avoir pour un chien fidèle et dévoué.
Il va suffir de trois fois rien pour que la flamme en elle se rallume. Non pas la flamme du sentiment, celle qui fait battre le cœur de son amie d’enfance Anne pour le beau Jean Azevado, révélant cruellement à ses yeux l’existence de la passion amoureuse, mais la flamme intérieure qui ronge et fait des ravages. Celle du regret et des frustrations, celle des rêves qui ne se réaliseront pas, celle de cette vie exaltante qu’elle ne connaîtra jamais.
Personnage souvent sombre et cruel, Thérèse Desqueyroux est une héroïne moderne : maîtresse de ses actes, y compris les plus répréhensibles, elle est pourtant l’éternelle victime d’un monde dans lequel elle ne trouve pas sa place, un monde d’hier dont la première guerre mondiale sonnera bientôt le début de la fin. Contrairement à Lady Chatterley ou à Emma Bovary, Thérèse Desqueyroux n’ira jamais au bout de son cheminement intérieur, en cela, elle demeure un personnage fascinant et inaccessible dont on ne parvient jamais à percer l’intime secret. votre commentaire
votre commentaire
-
Tout ce touche Clint Eastwood devient de l'or. Ce film est génial! Clint peut tout jouer et traiter de tous les sujets: il réussit à en faire un film prenant, intéressant. Les acteurs sont fantastiques, c'est fantastiques, le scnério est ficelé, et l'image est magnifique! tout est réussi.
scénario: 18/20 acteurs: 18/20 technique: 20/20 note finale: 19/20

Un découvreur de talents spécialisé dans le baseball voit sa vie basculer avec la perte progressive de sa vue. Il décide pourtant de faire un dernier voyage à Atlanta, accompagné de sa fille, à la recherche d'un talent prometteur.
 1 commentaire
1 commentaire
-
Un thriller très réussi: très bien fait, les acteurs sont remarquables dans leur déguisement années 80'. J'ai adoré.
scénario: 17/20 acteurs: 17/20 technique: 17/20 note finale: 17/20

Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade américaine de Téhéran, et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de "l’exfiltration" de la CIA du nom de Tony Mendez monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne pourrait exister qu’au cinéma.
 votre commentaire
votre commentaire
-
J'ai malheureusement vu ce film dans des conditions épouvantables: il y avait plein de vieux dans la salle, et comme vous le savez, les vieux sont la plaie des cinéméas car ils ne font que bavarder. Le vieux se croit devant sa télé quand il est au cinéma. Mais bref, je m'égare...
Les costumes et les décors sont magnifiques! Ce film sur la folie "l"hystérie" est réussi et les acteurs sont formidables. Les images sont magnifiques.
scénario: 16/20 acteurs: 16/20 technique: 18/20 note finale: 16/20

Paris, hiver 1885. A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse : l’hystérie. Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori, la vedette de ses démonstrations d’hypnose. D’objet d’étude, elle deviendra peu à peu objet de désir.
Le tableau est académique, un peu glaçant. On y voit une assemblée composée uniquement d’hommes, de noir vêtus, la plupart assis, quelques uns debout, tous attentifs. Leurs regards captivés convergent vers un point unique : un homme plus âgé, un brin empâté, qui tient en haleine cette audience disciplinée. Et puis à l’extrême droite du tableau, non loin du « maître », il y a Blanche. Les épaules dénudées, le corps qui s'affaisse en arrière, Blanche est un défi à cette discipline masculine, comme un appel à l'abandon. Une leçon clinique à la salpêtrière, tableau peint par l'oublié André Brouillet, a sans doute inspiré Alice Winocour pour son premier film, tout comme les nombreuses photos d’époque prises pour illustrer les écrits médicaux et rendre compte des corps tordus, des mimiques grotesques et presque sataniques de toutes les hystériques que le Professeur Jean-Martin Charcot, alors au faîte de sa célébrité, traitait dans son service.
Blanche a changé de nom, elle est devenue Augustine dans le film, mais c’est bien de cette patiente-là qu'il s’agit, celle de la leçon du tableau, celle à laquelle le Professeur Charcot consacra tant d’esquisses, de dessins et de théories. Nous sommes en 1885, à Paris. A l'hôpital de la Salpêtrière, la bourgeoisie bien née se presse pour assister aux spectaculaires présentations des « hystériques » du Professeur Charcot, comme on se hâterait à l’Exposition Universelle. Jeunes ou moins jeunes, souvent issues des milieux les plus pauvres, les malades forment autour du maître un drôle de sérail, troupeau un peu hagard, errant dans les couloirs sans fin d’une bâtisse qui a tout d’une prison. Des corps malmenés, quelquefois paralysés, parfois même insensibles à la douleur, au froid, au chaud, elles sont l’illustration dérangeante d’une maladie nouvelle : l’hystérie… Un mal au féminin qui jadis menait tout droit au bûcher mais qu’en cette fin du xixe siècle seuls les hommes interrogent, examinent, palpent, scrutent, auscultent, sans pudeur ni précaution.
Augustine arrive chez Charcot par la petite porte d’une crise de convulsions qui lui a fait perdre la sensibilité d'une moitié de son corps. Elle devient vite un cas d’école, l’illustration vivante des théories que le professeur élabore et qu’il souhaite très prochainement présenter auprès de ces messieurs de l’Académie de médecine, afin de financer le service dédié à ce mal fascinant. Augustine, qui ne sait ni lire ni écrire, fait pourtant preuve d’une grande lucidité sur la fascination qu’elle exerce sur Charcot, elle va se prendre au jeu de cette relation patient/malade où se mêlent l’attirance inavouables de deux corps, l’attachement affectif d’une naufragée à son sauveur, le délicieux avilissement de la servante à son maître. Au fil des hypnoses, des évanouissements et des crises où l’évocation du sexe, sans jamais être explicite, occupe le devant de la scène, la relation entre les deux s’aventure sur des chemins que le serment d’Hippocrate, la bienséance et la morale réprouvent.
Vincent Lindon, qu’on vient à peine de quitter en fils taiseux dans Quelques heures de printemps, incarne à merveille ce Charcot au corps un peu lourd, naturellement autoritaire, cet érudit passionné par sa spécialité qu’il aborde à la manière d’un artiste, cet homme du monde reconnu et jalousé qui élabore les bases sur lesquelles Sigmund Freud bâtira ses théories psychanalytiques. Sans tomber dans le piège d’une illustration trop didactique, de la reconstitution amidonnée, la débutante Alice Winocour parvient à montrer l’incroyable ébullition d’une époque qui voit la naissance du cinéma et de la psychanalyse, tout en demeurant indécrottablement misogyne, paternaliste et conservatrice. Et bien malin qui pourra dire lequel des deux, du médecin et de la patiente, du savant et de la servante, utilisera l’autre pour parvenir à ses fins : la renommée pour l’un, la liberté pour l’autre. 1 commentaire
1 commentaire
-
Ce film est réussi à tous les niveaux. Une pure merveille!!! Le scébario, est génial, les acteurs sont grandioses, la mise en scène est parfaitement réussie, les costumes sont magnifiques et les décors sont parfaits! J'ai adoré ce film historique! Du grand cinéma comme on aimerait en voir plus souvent!
scénario: 20/20 technique: 20/20 acteurs: 20/20 note finale: 20/20

L'histoire vraie d'un homme ordinaire qui gagne le cœur d'une reine et démarre une révolution. Centré sur le triangle amoureux constitué par Christian VII, roi cyclothymique et débauché, l'idéaliste Struensee, médecin imprégné de la pensée des Lumières, et la jeune reine Caroline Mathilde, Royal Affair relate l'épopée d'idéalistes audacieux qui, vingt ans avant la révolution française, risquèrent tout pour imposer des mesures en faveur du peuple.
C'est un film somptueux, sensuel et crépusculaire. Une histoire tout ce qu'il y a de vraie qui nous conte le Danemark tel qu'on l'ignore, pendant le bref instant où, touché par « les Lumières », il devint un exemple pour l'Europe entière. Au point que le grand Voltaire lui même prit la peine de dégainer sa plus belle plume pour célébrer l'intelligence de son roi, « la lumière du Nord »… Comment l'amour permit cette évolution incroyable, comment aussi il signa la perte des précurseurs qui avaient contribué à faire de ce petit pays une référence pour tous ceux qui rêvaient d'une société meilleure : Nikolaj Arcel réussit brillamment un film sans temps morts, parvenant, du plus intime au plus collectif, à décrire une société furieusement inégalitaire, trop douce pour les uns, trop dure pour la plupart ; un film porté par des comédiens magnifiques qui nous font croire au trouble de leur esprit comme aux élans de leurs corps et de leurs cœurs avides de liberté.
Fin du xviiie siècle. La noblesse égoïste et futile, soutenue par un clergé puissant et arrogant, règne en opprimant le petit peuple. A travers tout le continent, intellectuels et libres penseurs réclament réformes et justice, mais la cour du Danemark, trop préoccupée de ses intérêts, de ses querelles et de ses royales fêtes, est sourde aux échos du monde, et les gens souffrent, exploités, battus, punis de mort pour le simple fait d'avoir déplu à leur maître, croupissant dans des villes sales… On dit que le jeune roi Christian VII est fou, qu'il ne gouverne guère, tout occupé à boire et festoyer avec des « putes aux gros seins ». Lorsqu'on lui amène sa très jolie et intelligente cousine britannique pour qu'il donne un héritier au royaume, il en est quasi contrarié et la délaisse sitôt son devoir de reproduction accompli, si bien que Caroline Mathilde, la nouvelle reine, regrette amèrement sa douce Angleterre…
C'est alors que les ministres, embarrassés par ce monarque inconséquent et incontrôlable, décident de lui trouver un médecin pour s'occuper en permanence de lui. Parce que son père était un pasteur apprécié pour ses idées conservatrices, et que la brochette de ministres qui régente le royaume ne brille pas par son audace progressiste, c'est sur Johann Friedrich Struensee que se portera leur choix. Une forte personnalité, ce Struensee (Mads Mikkelsen : sacré Meilleur acteur au Festival de Cannes 2012) : bon vivant, libéral, humaniste, auteur lui-même de textes anonymes largement inspirés de Voltaire, Rousseau et quelques autres… Sa bienveillance naturelle, sa grande compréhension des hommes et son goût pour les plaisirs vont lui gagner la confiance et l'amitié de ce roi instable et léger qui va prendre un curieux tournant sous son influence, tandis que la reine trouve enfin à qui parler de ces lectures qui les nourrissent et les ouvrent à un monde que tous deux voudraient bien changer. Autant d'amour de la vie et de goût pour les idées élevées rend bientôt inévitable une relation fusionnelle, attisée par le sentiment de pouvoir peser sur l'évolution des choses. Sous leur influence, le roi aura tôt fait de se faire le porte-parole de réformes audacieuses tandis que les ministres et la régente commencent à s'alarmer… Prendre des sous sur les rentes des nobles pour nettoyer Copenhague de sa saleté, vacciner tout le peuple, abolir la torture, supprimer le servage, les châtiments corporels, éloigner l'église des questions publiques, proclamer la liberté de la presse… Voilà qui décoiffe le Conseil qui n'en revient pas et résiste à ces propositions farfelues. Qu'à cela ne tienne, le roi dissout le Conseil et décrète que le royaume sera désormais gouverné par un cabinet réduit à Struensee et lui-même, promulguant enfin les lois que le Conseil refusait de prendre au sérieux ! C'est fou le nombre de choses qui purent évoluer pendant cette petite année où Struensee resta aux manettes… Et comme tout ça n'est pas un conte de fées mais la vérité vraie, on se doute que la méchante douairière et la classe dominante vont tout faire pour mettre à mal ces nouvelles idées et ceux qui les mettent en pratique…
Les châteaux font rêver et les fêtes qui s'y donnent, superbement mises en scène, ne sont jamais empesées malgré la beauté de costumes, assumés comme si chacun portait là ses vêtements habituels, la musique accompagne sans être envahissante et le jeu des acteurs est bigrement contemporain. Pour tout ça, le film déborde largement la description d'une époque pour nous renvoyer aux valeurs bousculées de la nôtre.
Bien après la période racontée par le film, sachez que les idées de Struensee reprendront du poil de la bête quand Frédéric, le fils de Caroline Mathilde, deviendra roi sous le nom de Frédéric VI, lequel s'inspirera largement dans sa gouvernance de l'œuvre de sa mère et de son bien aimé. 1 commentaire
1 commentaire
-
Un film que je ne voulais pas aller voir: j'étais allée voir un autre film mais quand je suis arrivé dans la salle, il n'y avait que des Vieux (et vous savez que je déteste les vieux au cinéma car ils se croient devant leur télé, ils parlent tout le temps. le vieux est terrible au cinéma)! j'ai été si horrifié que je suis allé à la caisse voir si je ne pouvais pas changer mon billet. heureusement, ce fut possible et c'est ainsi que je suis allé voir ce magnifique film. Sandrine Bonnaire est aussi bonne réalisatrice qu'actrice: tout en subtilité, en douceur, en tendresse. les acteurs sont justes et touchants. Alexandra Lamy mériterait un prix d'interprétation tant elle est touchante. Ce film est une totale réussite. William Hurt nous prouve une fois de plus qu'il est un très grand acteur. Le petit garçon qui a le rôle principal joue très bien lui aussi.
J'enrage de son absence est un hymne magnifique à la vie et à l'amour, puissamment servi par une réalisatrice inspirée et des acteurs au sommet de leur talent. Une mention particulière au jeune Jalil Mehenni, absolument incroyable de subtilité et de finesse.
scénario: 17/20 acteurs: 18/20 technique: 17/20 note finale: 17/20

Après dix ans d’absence, Jacques ressurgit dans la vie de Mado, aujourd’hui mariée et mère de Paul, un garçon de sept ans. La relation de l’ancien couple est entachée du deuil d’un enfant. Alors que Mado a refait sa vie, Jacques en paraît incapable et lorsqu’il rencontre Paul, c’est un choc. La complicité de plus en plus marquée entre Jacques et Paul finit par déranger Mado qui leur interdit de se revoir. Mais Jacques ne compte pas en rester là...
C'est une de ces journées qui annoncent l'automne, une journée pas comme les autres, car tout est immobile autour de la petite maison. C'est un peu comme ces lendemains de Noël où tout semble figé dans un silence ouaté. Un joli moment de grâce, où l'on trouve enfin du temps à soi. C'est Dimanche. Pour Jacques, Mado et leur petit garçon, c'est un moment de simple bonheur qu'ils imaginent volontiers aussi éternel que le cycle des saisons. Autour de la table familiale et au coin du feu pour prendre le café, le temps s'écoule doucement pendant que la pendule égrène les heures. Peuvent-ils imaginer alors que celles du bonheur leur sont comptées lorsqu'ils décident d'aller marcher dans les bois, tant que le loup n'y est pas ? Mais le destin, ce jour-là, bien plus cruel encore que le loup, va à la croisée d'un chemin emporter leur petit garçon…
Bon, une fois n'est pas coutume, ce film-là n'existe pas, ces quelques mots qui racontent l'indicible sont comme la mémoire d'un souvenir terrible qui ne demande qu'à rester enfoui. Car il pose une question que personne n'aimerait avoir à se poser : peut-on faire le deuil d'un enfant quand on se croit responsable de sa disparition ? Peut-on apprivoiser la douleur, peut-on la faire taire ?
J'enrage de son absence n'efface pas la perte, mais affirme que, quelles que soient les circonstances et le temps, la vie, comme cette petite plante qui finit par percer le bitume, reprend toujours ses droits. On imagine ce couple, resté seul face à lui-même, muré chacun dans sa douleur, finissant sans désamour par se séparer pour simplement pouvoir continuer à vivre. Elle pour refaire, comme on dit, sa vie, lui sans trop parvenir à poursuivre la sienne. Séparés par l'océan : elle dans une banlieue française sans trop de grâce, lui en Amérique, sa terre d'origine.
Et soudain, dix ans après, il y a ce retour à Paris de Jacques l'Américain, pour régler une histoire de famille. Surgit alors le désir obsédant de savoir ce qu'elle est devenue et l'espoir inconscient, peut-être, de renouer le fil d'une vie en commun. Un peu comme un voleur d'abord, en l'observant de loin, puis en la suivant au plus près, fasciné par le petit bonhomme qui trottine à ses côtés sur le chemin de l'école ou quand elle fait ses courses. Puis un jour, n'y tenant plus, Jacques ressurgit dans la vie de Mado. L'intensité de leur première étreinte dévoile que leur amour est resté comme suspendu et qu'il a bien fallu un drame pour les forcer à se séparer. Sans doute est-il trop tard, car Mado vit avec un autre homme mais c'est une autre relation qui va déborder Jacques. On pensait que cet homme était mort de chagrin… et bien non.
J'enrage de son absence va raconter non pas la mort, non pas la tristesse, mais la vie qui reprend de la manière la plus étrange qui soit. Car c'est Paul, le petit garçon de Mado qui, tel Androclès, va retirer l'épine de la patte du lion en dépit de tout et de tous. Un goûter apporté à la sortie de l'école, des liens construits à travers le jeu, un jouet offert à la fête foraine… toute une relation va s'établir entre l'adulte et le petit garçon, qui se sent investi d'une mission immense : sauver la vie d'un grand. Paul est bien l'oiseau qui soigne le lion. Il n'a pas peur de Jacques, il ne le juge pas, il a toute confiance en lui car la bête ne lui semble pas méchante. On le sait peu, mais les enfants savent écouter leurs intuitions beaucoup plus que leurs adultes et lorsqu'ils perçoivent un profond chagrin, ils savent être vraiment présents… votre commentaire
votre commentaire
-
Un très très joli film sur la fin d'un monde, celui des kibboutz. C'est filmé avec douceur et je pense que nous avons affaire à un grand réalisateur dont j'attends le prochain film avec impatience.
scénario: 18/20 technique: 18/20 acteurs: 18/20 note finale: 18/20
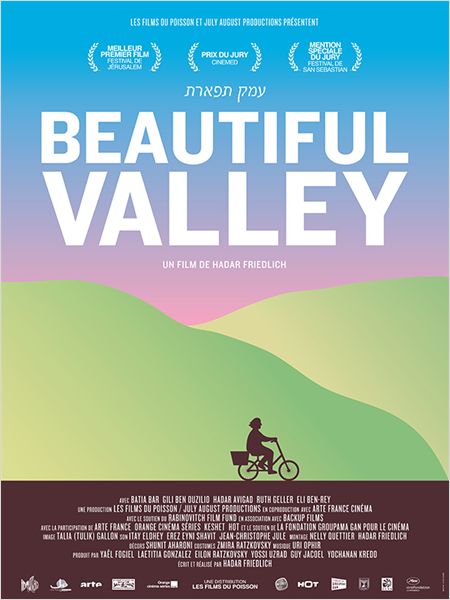
"C'est cette idée de partage qui nous a plu en arrivant !". Ainsi parle le meilleur ami d’Hanna, vétéran comme elle du kibboutz qu’ils ont contribué à créer. Mais à l’âge de 80 ans, Hanna est poussée plus ou moins délicatement vers la sortie par la nouvelle génération. Les temps changent, les utopies sont désormais des souvenirs et la privatisation du kibboutz, au bord de la faillite, semble inévitable. Inévitable ? Pas pour Hanna qui va s’y opposer. Même si c’est sa propre fille qui orchestre le démantèlement de ce rêve de toute une jeunesse.
Elle en avait pourtant rêvé, Hanna, de cette terre d’abondance « où coule le lait et le miel ». Elle avait déboulé d’Europe où les Juifs étaient persécutés et elle avait aimé cette idée de partage qui unissait les pionniers venus là pour inventer une société idéale sans hiérarchie, où les hommes et les femmes étaient égaux entre eux, mettaient ensemble leurs forces pour faire produire le meilleur à la terre, partageaient tout et se croyaient définitivement solidaires. Nul besoin de se soucier de sa subsistance individuelle, le kibboutz prenait en charge les besoins matériels et chacun donnait le meilleur de lui-même pour construire une société socialiste, laïque, forte et conquérante, comme il ne s’en est pas vu beaucoup.
A un petit vol d’oiseau du premier kibboutz créé en 1909, Hanna avait contribué à bâtir de toutes pièces ce kibboutz Gesher, tout près de la frontière Jordanienne, impulsé par une poignée de Juifs de Palestine, d’Allemands, vite rejoints par des Polonais… sur des terres acquises grâce à l’aide d’Edmond de Rothschild en 1939 dans une riante vallée au nord d’Israël.
Elle y avait rencontré son mari, son ami Shimon… Tous avaient travaillé dur, dans des conditions difficiles, de celles qui scellent les amitiés fortes, et tous se sentaient indestructibles, sûrs de leur choix. Pour cet idéal, ils avaient quitté père et mère, abandonné une carrière individuelle de musicien, d’écrivain : leur Utopie comptait plus que leur destins personnels… Les enfants étaient élevés collectivement et même les vêtements passaient de l’un à l’autre : abolir la notion de propriété individuelle pour s’attacher à l’essentiel… on parlait, on étudiait, on faisait de la musique ensemble, on chantait.
Hanna a maintenant plus de 80 ans, et si son utopie bat de l’aile, elle continue à s’acharner à transmettre des idéaux dont même les plus vieux finissent par ne plus parler. Dans son bureau on aperçoit un portrait de Lénine…
Le libéralisme a gagné du terrain, le kibboutz est en faillite et elle vit mal qu’on veuille la mettre sur la touche alors qu’il est impensable pour elle de ne pas continuer à participer de sa petite pierre à l’édification d’un avenir meilleur. Mais l’utopie n’est plus ce qu’elle était, seul est resté le nationalisme, et il a désormais une sale gueule sans cette ambition généreuse qui leur faisait ignorer les souffrances sur lesquelles ils construisaient leur monde idéal. Sa fille quitte le kibboutz pour aller faire carrière, et elle-même est contrainte, contrairement aux principes d’origine, d’ouvrir un compte en banque personnel ; ceux qui peuvent s’en vont, les autres restent chacun chez soi et les vieux sont de trop : « tu me piques mon travail » lui dit une de ses voisines plus jeune, les enfants ont disparu du décor… Le grand élan a accouché d’une société individualiste et cruelle, « moderne » vous diront certains. Les cultures sont protégées par des barbelés et un mirador, mais les arbres doucement balancent leurs branches au vent : « les palmiers sont toujours les palmiers, les étangs des étangs… peu importe l’idéologie qu’il y a derrière tout ça » dit son vieil ami Shimon dont il ne lui reste désormais qu’une voix et une image sur une VHS qui aurait dû faire partie d’une exposition qui n’aura pas lieu… « Nous avons tant travaillé et maintenant nous devrions combattre nos fils ? » soupire-t-il, désabusé.
C’est un très beau film doux et triste, dont la lenteur va bien avec l’âge qui gagne, la pensée y a le temps de se laisser guider par le regard d’Hanna, jeune femme qui ne s’est pas vue vieillir tant elle restait accrochée à une utopie qui n’en finit pas de se déliter et la laisse sur le carreau, désabusée, mais toujours convaincue qu’elle a eu raison de tenter l’aventure… votre commentaire
votre commentaire
-
Un pur navet. Ennuyeux, sans queue ni tête.
scénario: 2/20 technique: 2/20 acteurs: 10/20 note finale: 4/20

Arash est un universitaire iranien qui vit en Occident. Il retourne donner des cours à Chiraz où vit sa mère, loin de Téhéran. Entraîné dans un tourbillon d’intrigues familiales et financières, il replonge dans un pays dont il ne possède plus les codes. A la mort de son père, découvrant ce qu’est devenue sa "famille respectable", il est contraint de faire des choix.
C’est à la fois un thriller psychologique prenant et une plongée fascinante dans l’absurdité d’un pays miné par ses contradictions, son passé non assumé, une corruption qui gangrène tous les étages de la société. C'est cette réalité que découvre, avec les yeux d’un candide horrifié, Arash, jeune universitaire qui vit depuis plus de vingt ans en Occident où il a fait ses études et qui est revenu à Chiraz, loin de Téhéran, pour soutenir sa mère tandis que son père se meurt et pour donner des cours à la fac.
Arash se heurte à la difficulté d’enseigner dans un pays où l’on ne peut pas utiliser n’importe quel texte, beaucoup étant censurés, où l’on ne peut pas aborder l’histoire iranienne de n’importe quelle façon, les censeurs veillant là encore au grain. Il affronte aussi une histoire familiale compliquée. Sa mère a quitté depuis longtemps son père qui menait une double vie avec une autre femme et un autre enfant, un père à qui son épouse n’a jamais pardonné la mort de son fils cadet, tombé en martyr lors de la guerre Iran/Irak, poussé par son père à s'engager. Le père est donc mourant et, rongé par le remords, il a décidé de léguer à son ex-femme et à Arash sa fortune, en grande partie constituée de l’indemnité de guerre de son fils défunt. Mais la mère refuse obstinément cet argent souillé selon elle par le sang de son cadet. Arash rencontre alors son demi-frère Jafar, devenu un homme d’affaires redoutable, son épouse Zoreh, ancienne compagne de jeux d’enfance d’Arash et devenue depuis une femme très pieuse, obsédée par la pureté, et enfin son neveu Hamed qui semble vouloir l'aider dans toutes ses démarches et réconcilier l’ensemble de la famille.
Mais tous ces gens ont ils de si bonnes intentions envers Arash ? Comment expliquer le meurtre mystérieux du notaire de famille ? Pourquoi Zoreh semble -t-elle détester son fils, nettoyant tout derrière lui de manière compulsive ? Pourquoi Hamed est-il si empressé de l’aider dans ses démarches pour obtenir son passeport qui lui permettra de revenir en France ?
Massoud Bakhshi sait parfaitement distiller l’ambiance délétère qui s’installe au cœur de la famille. Il décrit bien le cheminement d’Arash qui, arrivé pour repartir le plus vite possible, découvre peu à peu, avec inquiétude mais aussi avec passion, la violence et la complexité de la société iranienne dont il avait peu d’idées en tant qu’Iranien de l’étranger et dont il comprend peu à peu qu’elle est aussi sienne. Le réalisateur installe son personnage via des flashbacks intelligemment répartis dans ce passé cruel, cette enfance puis cette adolescence passées durant la guerre Iran/Irak qui prit à chaque famille son lot de martyrs. Une guerre qui marqua irrémédiablement toute une génération, celle justement de Massoud Bakhshi.
Une autre force du film est la place qu’il réserve aux femmes. Alors que les hommes sont souvent des lâches, des salauds ou des victimes plus ou moins résignées, les femmes sont là et bien là, figures de la résistance : la mère d’Arash, bloc de dignité et de ténacité que l’argent ne peut corrompre, Zoreh, qui s’est réfugiée dans la piété pour refuser d’être complice de l’avidité et de la duplicité de ses proches, et même la jeune Hoda, nièce d’Arash, qui représente le pendant positif d’Hamed, une jeunesse qui aspire à la vie et à l’ouverture. Et c’est bien vers cette ouverture que se tourne peu à peu Arash, et le film, parti pour être sombre, devient au final porteur d’un bel espoir… votre commentaire
votre commentaire
-
Pas mal quoiqu'un peu ennuyeux. Il manque un je ne sais quoi pour que ce film soit totalement réussi. Michel Delpech est formidable.
scénario: 14/20 acteurs: 15/20 technique: 15/20 note finale: 14/20

Il y a trente ans, Michel enchaînait les tubes. Aujourd’hui, il collectionne les dettes ! Retiré à la campagne, l’ancien chanteur accumule les retards d’impôts et amendes impayées.
Il y a trente ans, Grégory Morel était bercé au son des succès de Michel. Aujourd’hui huissier de justice, il est mandaté pour le saisir. Mais Grégory ne se sent pas de confisquer les biens de l’ex-idole. Il se met en tête de l’aider à rembourser et entraîne Michel sur les routes d’une improbable tournée. Au fil des concerts et des kilomètres, Grégory et Michel vont, l’air de rien, se découvrir et régler bien d’autres passifs.C'est un de ces films qu'on couve avec amour à Utopia, pétri de sensibilité et de nuances, réaliste et rêveur, drôle et touchant à la fois… C'est l'histoire d'un jeune huissier de justice… ouais, je vous vois déjà froncer le nez : pas le genre de boulot qui fait rêver ! Pas un lardon qui, à la question rituelle, répondrait : quand je serai grand, je serai huissier ! Nous plaiderons votre honneur les circonstances atténuantes, cet huissier-là l'est devenu par héritage plus que par choix : quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de sa vie, il arrive qu'il soit plus simple de prendre ce qui vous arrive par transmission.
Pour Grégory, la charge lui est échue à la mort de son père, par ailleurs fan de Michel Delpech dont les chansons ont imprégné son enfance d'une sorte de culture populaire pleine de poésie, lui laissant en héritage une flopée de ces mélodies sensibles qui s'accrochent pour toujours à la mémoire, peu propices à l'éclosion du tempérament féroce qui conviendrait mieux pour assumer le boulot qui est désormais le sien.
Ça saute aux yeux en effet dès le premier regard : Grégory n'a pas l'étoffe qu'il faut pour traquer le mauvais payeur, le harceler, le dépouiller et le jeter tout nu à la rue, pour rester de marbre devant les pleurs de la veuve et de l'orphelin, du chef d'entreprise ruiné, des victimes de plans de licenciements. C'est pourtant un bon job, huissier, étant donné l'air austère du temps, le boulot n'est pas près de manquer, mais il y faut un minimum de dispositions naturelles que Grégory n'a pas. Et lorsqu'il découvre, dans la liste des saisies à mettre en route, le nom de Delpech Michel, l'idole de son père, sa vie va furieusement se compliquer et sa vraie nature se révéler.
Sic transit gloria mundi… Michel Delpech – formidable dans son propre rôle – est sorti des radars du show-biz après avoir accumulé les succès il y a un certain nombre d'années, il empile désormais les dettes et, dans le trou perdu où il mène une vie solitaire (mais peinarde), tout ce qu'il possède est à saisir : voiture de sport, maison…
Quand l'huissier Gregory déboule, le chanteur reçoit l'annonce des calamités qui lui pendent au nez avec un détachement et une désinvolture qui alertent son tourmenteur patenté. Pas de doute, ce glorieux déchu s'en fout et ne bougera pas le petit doigt pour sauver ce qui lui reste. Au nom de son père, et de sa propre enfance, Grégory se met alors en tête de sauver l'heureux loser de la mouise promise en organisant une tournée revival pour qu'il puisse payer ses dettes et qu'il n'aie surtout pas à le saisir.
Il en est sûr, les chansons de Delpech sont tellement chouettes qu'elles courent toujours dans les rues, ceux qui l'aimaient n'ont pu l'oublier et ses fans se déplaceront en masse pour assister aux concerts. Trouver des lieux pour se produire ? Il ne manque pas dans les dossiers de l'huissier de salles paumées au bord du dépôt de bilan, elles feront l'affaire ! Et le voilà à magouiller des arrangements pour le moins tordus, collant des affiches la nuit un peu partout, tandis que son associé, un vrai dur à cuire, lui, s'étonne de le trouver si flapi alors que ses saisies n'avancent pas d'un poil.
Notre épatant Gregory va tirer, pousser le chanteur au départ peu enthousiaste, et le duo improbable va se lancer dans son équipée salvatrice, nous emportant dans une sorte de balade du temps présent qui charrie les souvenirs passés comme une comète sa poussière d'étoiles.
C'est un film formidablement attachant, qui fait un bien fou parce qu'il magnifie ces décalés improbables, dépités par les fausses valeurs régissant le monde, et qui font un pas de côté pour s'inventer une toute autre trajectoire. votre commentaire
votre commentaire
-
Une jolie comédie sans prétention. Diane Kruger est extrêmement jolie et bien filmée. Après, ce n'est pas la comédie du siècle. On voit le Kenya, la Russie, c'est beau.
scénario: 15/20 acteurs: 16/20 technique: 16/20 note finale: 16/20

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, Isabelle a une stratégie pour épouser l'homme qu'elle aime : trouver un pigeon, le séduire, l’épouser et divorcer.
Un plan parfait si la cible n’était l'infernal Jean-Yves Berthier, rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou.
Un périple nuptial pour le meilleur et surtout pour le pire. votre commentaire
votre commentaire
-
Ouai, bof. Déception. Le scénario est vraiment léger et les acteurs semblent perdus.c'est bien joli mais tout cela tourne à vide et il manque une histoire.
scénario: 12/20 acteurs: 16/20 technique: 16/20 note finale: 13/20

Michaël, Nabil et Sylvain, trois trentenaires de Nanterre, débarquent à New York par surprise à l'occasion de l’anniversaire de Samia, leur amie d'enfance. C'est Gabrielle, elle aussi une amie de toujours qui a tout organisé. Les deux copines ont quitté leur cité depuis deux ans pour tenter leurs chances aux États-Unis. Samia est l'assistante personnelle d'une célèbre comédienne avec qui elle partage un sublime appartement. Gabrielle, quant à elle, travaille dans une maison de retraite où elle a lié une relation tendre avec Mme Hazan, une Française placée ici par ses enfants.
Transposés à New York, les liens étroits tissés depuis toujours prennent un relief particulier, au rythme des péripéties de leur séjour, du quotidien new-yorkais des deux amies et de la découverte de la ville culte... 1 commentaire
1 commentaire
-
Un très très très beau film israélien. L'histoire de ce jeune bédouin est touchante et pleine d'espoir.
scénario: 17/20 technique: 16/20 acteurs: 17/20 note finale: 17/20
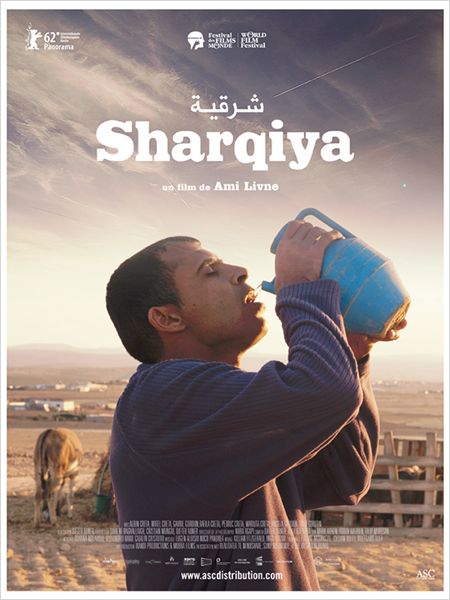
Kamel, un jeune Bédouin, travaille comme agent de sécurité à la gare routière de Be'er Sheva. Il habite dans un petit village illégal, perdu au beau milieu du désert.
Son frère Khaled, chef du village, travaille dans la construction et est marié à Nadia, 21 ans. La relation entre les deux frères est compliquée, Khaled n’approuvant pas le métier de Kamel. Un jour, en rentrant chez lui, Kamel apprend que les autorités ont ordonné la démolition du village. Dès le lendemain, Khaled quitte son emploi et décide de rester au village, pour repousser les autorités qui tenteraient de les déloger. Kamel, quant à lui, continue d'aller à son travail...Sharqiya en arabe, c’est ce vent venu de l’Est, mauvais et dangereux, qui balaye le désert du Neguev au Sud d’Israël. Un vent qui complique l'existence déjà pas simple des Bédouins qui vivent sur ce territoire. Des Bédouins qui sont très souvent israéliens depuis bien plus longtemps que certains de leurs voisins juifs mais qui sont pourtant traités comme des citoyens de seconde zone, tout en étant ignorés des mobilisations internationales contrairement à leurs frères palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza.
Kamel est un de ces Bédouins d'Israël. Il partage avec son frère et sa belle-sœur deux cabanes de guingois, tôles et planches assemblées tant bien que mal au milieu de rien, sur une terre aride que l’on croirait oubliée de Dieu mais sur laquelle ils parviennent à élever quelques chèvres. Mais ça ne suffit pas à faire bouillir la marmite ou à payer le peu d’essence nécessaire au groupe électrogène poussif qui donne le peu de lumière indispensable par exemple à la belle sœur de Kamel qui s'efforce de lire en espérant reprendre des études. Alors tous les matins, avant même que le soleil se lève, Kamel prend le bus et rejoint la gare routière où il exerce son métier de vigile, chargé notamment de traquer les colis suspects, dans un pays où la crainte de l’attentat est une obsession constante. Un métier qu’il exerce avec zèle, ce qui n’empêche pas ses collègues d’avoir envers lui une méfiance un peu paternaliste, Kamel étant relégué tout seul à la surveillance de l’entrée de la gare pendant que les autres vigiles patrouillent souvent à deux à l’intérieur. Et lorsqu'il rentre chez lui, il doit affronter le mépris de son frère, qui accepte l’argent qu’il rapporte, mais qui désapprouve sa collaboration avec un employeur juif…
On espérerait que la vie de ces trois isolés, qui ne gênent strictement personne, puisse au moins se poursuivre tranquillement. Mais non : un jour arrive un avis de démolition. Comme à beaucoup de Bédouins installés dans le désert bien avant 1948, leur terre leur a été concédée d’une simple poignée de main en échange de leur neutralité ; et aujourd’hui l’administration israélienne a décidé de traquer les habitations qu’elle considère comme illégales puisque jamais ratifiées par un acte de propriété. Et le sharqiya, le vent mauvais, devient la parabole de ces 4x4 blancs remplis de fonctionnaires israéliens sans états d'âme qui s’abattent régulièrement sur ces malheureux et détruisent leurs maisons.
Le très beau film d’Ami Livne, qui a justement grandi dans le Néguev, montre la cruauté et l’absurdité du sort réservé aux Bédouins – en même temps qu'il fait découvrir leur existence à la plupart d'entre nous. Il le fait avec une sobriété et une intelligence rares, avec une belle maîtrise formelle aussi : il traduit magnifiquement la beauté et la dureté de ces paysages désolés. Le personnage de Kamel est particulièrement fort et complexe : il croit jusqu’au bout à l’Etat de droit israélien, sollicitant en vain la compréhension de l’administration, imaginant un subterfuge pour interpeller les médias qui le trahiront… Et alors qu'approche l'inéluctable, on sent monter chez lui la colère sourde, l’indignation digne et sans violence propres aux peuples fiers et éternels. Kamel est incarné par un jeune Bédouin totalement amateur, qui a joué le personnage en cachette de son village et qui insuffle à son personnage toute la retenue mais aussi la détermination qui l’habite. La remarquable scène finale, dont on ne vous révélera rien, est à la fois terrible et pleine d’espoir, montrant bien que quoi qu’il fasse, l’Etat israélien ne vaincra jamais par la force la détermination de ceux qui ont habité cette terre bien avant qu'il se l'approprie. votre commentaire
votre commentaire
-
La première heure de ce film est un horreur: c'est nul, c'est lent, sans intérêt, très très très enuuyeux etc... mais si vous survivez à cette première heure, ce qui est très difficile car j'ai moi-même failli partiur 10 fois en me demandant ce que je faisais dans la salle, vous serez récompensé par une seconde partie intéressante et pleine de surprises!
scénario: 12/20 acteurs: 16/20 technique: 16/20 note finale: 13/20

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître tous les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où des tueurs d’un genre nouveau (les "Loopers") les éliminent. Un jour, l’un d’entre eux, Joe, découvre que la victime qu’il doit exécuter n’est autre que… lui-même, avec 20 ans de plus. La machine si bien huilée déraille…
 votre commentaire
votre commentaire
-
Tim Burton est un génie: tout ce qu'il touche devient de l'or! Cette fable moderne est une totale réussite.
scénario: 16/20 technique: 16/20 note finale: 16/20 note finale: 16/20

Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son cru… Victor va tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et la ville tout entière vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir quelques monstrueuses conséquences…
 votre commentaire
votre commentaire
-
Un film inqualifiable: mi film, mi documentaire, très amusant et en même temps invitant à la réflexion. J'ai beaucoup ri. C'est très réussi/ j'espère que nous aurons le plaisir de voir un nouveau film de ce réalisateur prochainement.
scénario: 17/20 technique: 17/20 acteurs: 16/20 note finale: 17/20

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire un film sur les apparitions miraculeuses de la Vierge au sein de la communauté copte chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. Il y a peut-être un message dans tout ça. »
Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour revoir sa famille, et pour impliquer tout le village dans une rocambolesque mise en scène…Des entreprises les plus hasardeuses, les plus filandreuses, naissent parfois des pépites. En voici une nouvelle preuve avec ce film à la fois improbable et incroyablement drôle, et intelligent et magnifiquement humain… Namir Abdel Messeeh, jeune réalisateur d’origine égyptienne, décide, en plein bouleversement des printemps arabes, de réaliser un documentaire sur les Coptes, grosse minorité chrétienne d’Egypte (10% de la population) à travers le phénomène des apparitions de la Vierge, souvent signalées en Haute-Egypte. Il réussit à intéresser un producteur à son projet pas évident…
Le point de départ vient de la mère de Namir qui affirme avoir vu distinctement, sur une cassette vidéo relatant un rassemblement religieux, apparaître Marie, la bienheureuse mère de Dieu. La première scène du film montre donc le visionnement en famille (Namir, son épouse enceinte, son père, sa mère) de la dite cassette. Mais ce jour là, face au petit écran, la mère ne voit pas la Vierge ! Première grosse engueulade avec le producteur, qui commence à croire qu’on le prend pour une quiche…Namir persévère néanmoins et part au Caire rencontrer les sommités de la communauté copte. Mais la tâche n'est pas facile quand on ne sait pas cacher son scepticisme agnostique face à des religieux, a fortiori dans un pays où chrétiens et musulmans s’entendent assez bien pour rejeter toute personne qui a le culot d’afficher son athéisme… Là le producteur devient vraiment nerveux. Et finalement Namir se dit que la meilleure solution pour réussir à tourner son film est de rejoindre sa famille en Haute Egypte, région dans laquelle il a vécu ses premières années, et aller ainsi à la rencontre des vrais croyants en la Vierge. Et si – éventualité plus que probable – la Vierge ne vient pas à eux, il imagine de récréer son apparition avec la participation des villageois et l'apport de puissants effets spéciaux maison comme un système de poulie artisanal destiné à faire léviter la jeune fille élue pour représenter Marie… Autant dire qu'à ce stade, le producteur a carrément pété les plombs.
Dans un système hilarant fleurant bon la liberté totale et l'humour iconoclaste, Namir Abdel Messeeh mêle joyeusement regard tendre et approche documentaire sur ce village copte et ses habitants géniaux qui jouent tous le jeu du cinéaste, même quand ils commencent à se demander s’il n’est pas un peu maboule. Sans parler de ses ruses diverses, qui piègent même sa mère, ignorant qu'elle est filmée… Ainsi cette scène où elle découvre furax par Internet depuis Paris que son fils filme sa famille malgré son désaccord formel et qu’elle le menace d’un procès ! Ou dans cette autre où ils détournent un compteur d’électricité et qu’elle prie Dieu que ça ne se sache jamais… Car il faut vous dire que, réconciliée avec son fils, Siham a pris l'avion, est arrivée sur place et qu'elle est devenue – et ça c'est vraiment très très drôle – productrice par défaut, assurant l’intendance de l’impossible tournage au cœur de la Haute Egypte. Mais au-delà d’un grand film burlesque, La Vierge, les Coptes et moi est une approche passionnante de la foi et des ressorts de la croyance, dans un pays de tout temps marqué par la religion et les conflits qui vont avec. Et le talent de Namir est grand, qui a réussi un film sérieux qui ne se prend jamais au sérieux et qui nous fait même franchement rire. votre commentaire
votre commentaire
-
Un très joli film qui dénonce avec tout le talent de Costa Gavras l'impitoyable monde de la finance. On peut regretter quelques mouvements de camera malheureux.
scénario: 17/20 acteurs: 17/20 technique: 15/20 note finale: 17/20

La résistible ascension d'un valet de banque dans le monde féroce du Capital.
Jubilatoire. En pleine crise économique et sur fond de réforme bancaire (il est question de séparer les activités bancaires dites « spéculatives » ou encore « de marché » des activités de dépôt et de crédit), il était bon, même si les sabots sont ici ou là un peu lourds (mais le sujet s’y prête très bien), de nous rappeler – voire nous informer – ce qui continue de se tramer au-dessus de nos têtes, en dehors des urnes, et de la justice, en toute impunité ou presque, dans l’univers impitoyable de la haute finance. Et la bonne idée de Costa-Gavras, c’est de le faire de l’intérieur, à travers le parcours, l’ascension d’un quadragénaire, Marc Tourneuil (Gad Elmaleh), polytechnicien zélé mais sans charisme particulier, propulsé par ses pairs, à la suite d’une crise cardiaque du directeur en place (Daniel Mesguich, napoléonien), à la direction d’une des plus grandes banques européennes, Phénix. En fait le Conseil d’Administration de la banque, qui l’imagine manipulable parce que sans expérience, ne voit en lui qu’un intérimaire, en attendant que l’ancien directeur recouvre la santé ou le temps de trouver une « pointure » indiscutable. Mais Tourneuil va se révéler redoutable… car cet univers, il le connaît comme sa poche, qu’il a béante… Toute cette histoire nous fait bien sûr penser à Goldman Sachs, « la banque qui dirige le monde ».
Personnages et spectateurs sont emportés dans le tourbillon infernal de la haute finance, ses coups tordus, et tous les bonus qui vont avec (signes extérieurs de richesses et reflets d’un narcissisme hors normes) : sexe facile, belles gonzesses, costumes sur mesure, décors luxueux, voyages en jet privé USA-France, rendez-vous sur un superbe yacht avec des Américains représentant un fonds d’investissement spéculatif (Gabriel Byrne en chef requin), dîners intimes dans des restos gastro avec des hommes de l’ombre appartenant au gouvernement, ou avec des dictateurs de pays pétroliers, ou riches en uranium, soirées mondaines dans des musées privatisés pour l’occasion avec journalistes, politiques, grands chefs d’entreprises… À propos de dîner, on pense bien sûr au Dîner du siècle, ou au groupe Bilderberg, ces attroupements de gens dit « influents » qui parlent et décident en secret de la destinée économique du monde. Des attroupements qu’on ne disperse jamais et qui pourtant troublent l’ordre public, et pas qu’un peu !
Tout ce petit monde avide de pouvoir et d’argent vit sur une autre planète, la finance est un jeu de dupes : qui gagne un jour en bourse détient le pouvoir, qui perd le lendemain en est dépossédé. Objectif unique : se battre sans cesse pour ne pas se laisser dominer à son tour, tout faire pour s’élever au-dessus des marchés, assurer l’approvisionnement en pognon, satisfaire toujours plus les actionnaires et augmenter les rémunérations des dirigeants. Pour y arriver : inventer, grâce au boulot d’une kyrielle de mathématiciens et de logiciels, toujours plus de produits financiers (subprimes, hedge funds, stock options, rachat de banques aux actifs pourris…), de combines, manipuler les employés pour mieux licencier, au besoin avec l’aide des méthodes de Mao et des techniques de communication de Bill Gates (ce qui nous vaut une scène spectaculaire).
On est loin de la fable philosophique de Cronenberg, Cosmopolis (que j'vais trouvée nullissime!), plus proche de Margin call. Dans leur souci pédagogique, Costa-Gavras et ses scénaristes simplifient un peu trop ici, alourdissent le trait là (les scènes imaginées par Tourneuil, la voix off un peu insistante…). Mais malgré ses imperfections, le film est efficace et bienvenu en cette période où les rappels à la mémoire et les éclaircissements sont plus que jamais nécessaires. 2 commentaires
2 commentaires Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires