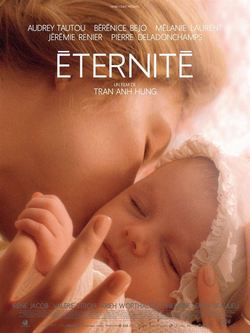-
Dans un décor à la blancheur sereine, on assiste entre mélancolie et résignation à la lente et inéluctable disparition d’un mode de vie désormais révolu. De cet univers glacé ressort la chaleur de sentiments puissants éprouvés par deux êtres dont le regard est orienté dans une même direction. Visuellement splendide, "Aga" est une leçon d’amour. Ce film est une merveille à tous les niveaux.
scénario: 20/20 technique: 20/20 acteurs: 20/20 note finale: 20/20

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple du Grand Nord. Jour après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille.
Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu.Une étendue de rêve immaculée… Ici le ciel finit par se confondre avec la terre. Ici le moindre bruissement résonne comme un début de chanson ancestrale dont seuls les Iakouts devinent la rime. Nous sommes au bout du monde, au nord de la Sibérie. Nanouk et Sedna semblent avoir perdu leur âge au détour d’une de ces dunes d'un blanc limpide. Partout la neige nous enrobe de sa beauté glacée mais néanmoins organique. Seules les tenues traditionnelles de Sedna, le son de sa guimbarde bousculent l’ordre établi par le sempiternel hiver feutré, amènent la touche colorée qui permet d’espérer un printemps. Le climat polaire qui givre toute chose ne semble jamais atteindre les cœurs du vieux couple. Ils battent chaleureusement au gré d’une tendresse immuable, déteignant l’un sur l’autre, prenant soin l’un de l’autre, sans avoir besoin de le déclarer. Peu de mots se disent, aucune grande déclaration. Peut-être par peur de troubler la quiétude environnante, ou tout simplement parce que ce n’est pas l’usage dans cette civilisation en voie de disparition.
Au-dessus de leurs têtes les avions passent haut dans le ciel, laissant des trainées qui ne tarderont pas à disparaitre, elles aussi. Parfois la radio leur amène une musique lointaine. Parfois un ravitaillement venu d’une ville lointaine parvient jusqu’ici. Que l’époque change, que les moteurs vrombissent, Sedna et Nanouk restent-là au fond de la toundra avec, comme seuls remparts contre les tempêtes, les tentures de peau de leur frêle yourte. Rivés à un quotidien pragmatique, ils se contentent de vivre en essayant de rendre leur monde moins hostile, avec pour compagnon leur chien de traineau tout aussi attentif et silencieux qu’eux. Les jours se succèdent, paisibles, amoureux. Les actes le prouvent. Nanouk sait quand passe le gibier, où creuser la glace pour ramener du poisson ou tout simplement de l’eau potable. Sedna connait les rares herbes qui poussent dans la toundra, celles qui soignent, les manières d’accommoder leur maigre pitance. Ils se guettent, s’attendent en silence. On goute la luminosité des paysages, le calme de leur quotidien rempli d’âme, d’écoute. On les découvre seuls, courageux, on les admire. Ensemble ils forment un tout qui se complète, comme deux inséparables. Puis on se prend à redouter le pire… On ne sait trop pourquoi. Un sentiment diffus, un danger qui guette, tapi dans l’ombre, les saisons qui se dérèglent, le temps qui semble s’accélérer. Et puis Aga… Ce prénom inoubliable qu’on évite de prononcer, mais qui rôde dans les têtes, qui plane toujours à proximité.
Milko Lazarov, cinéaste bulgare dont c'est le deuxième film, nous offre un moment inoubliable, terriblement beau. Il suffit de se laisser transporter dans son rythme particulier, bien emmitouflé dans notre confort moderne. Alors la magie opère, magistrale, tenace. Les prises de vues sont sublimes, qu’elles embrassent les paysages infinis ou se glissent au plus près des acteurs. votre commentaire
votre commentaire
-
Un film hors du temps sur la pauvreté. Bof, je n'ai pas tellement accroché.
scénario: 12/20 acteurs: 14/20 technique: 16/20 note finale: 12/20

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna.
La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro.
Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.C’est un film hors du temps, lumineux, qui démarre pourtant dans la nuit sombre. Une curieuse clique de musiciens vient chanter une aubade devant une modeste masure. La maisonnée grouillante s’agite. La belle désirée écoute cette déclaration d’amour intime qui se brouille dans la promiscuité incontournable du logis surpeuplé. Ça chahute, ça rigole, ça braille, ça prend des airs goguenards. Tendrement on observe cette engeance misérable et joviale, hommes, femmes, enfants, vieux, un brin affreux, sales et parfois méchants quand ils se moquent. Et ils se moquent souvent et principalement de Lazzaro, de ses airs d’éternel ravi de la crèche. Lui semble observer le monde dans un perpétuel état d’émerveillement. Hermétiques à la noirceur environnante, ses grands yeux écarquillés gobent la beauté qui l’entoure, accueillant toute chose au premier degré. Presque mutique, on pourrait le croire benêt. Puis s’impose à nous une forme d’évidence : cette naïveté presque risible, immaculée, peut-être est-ce cela qu’on appelle la bonté. Une bonté à l’état pur qui jamais ne se parjure. Jamais Lazzaro ne se défile pour rendre un service. Jamais il ne se rebelle, encaissant humblement quolibets et injustices. Dans son cœur aucune aigreur. Toujours prêt à aider même les plus mauvais payeurs, sans rancune. Et on se prend à l’aimer, comme tous ceux qui pourtant se moquent. Étrange dualité qui nous oblige à envisager de nouveaux niveaux de lecture et à nous extraire des simples apparences. Dès lors, tout prend une autre saveur.
Ici, les champs sont beaux, les potagers bien entretenus, malgré la nature parfois rude qui refuse de se laisser complètement domestiquer. Nous sommes à Inviolata, littéralement « inviolée », pure, vierge… Une terre préservée… mais de quoi au juste ? Cette métairie perdue quelque part au fond de l’Italie profonde semble figée sous le joug d’une féodalité rétrograde. Pourtant… progressivement on se questionne. Quelques détails ne collent pas. Si les moyens et la manière de vivre restent moyenâgeux, les tissus des vêtements semblent bien contemporains. Et l’arrivée de la marquise Alfonsina de Luna, terrible maîtresse des lieux, de ses sbires sur leurs vélos solex, avec leurs téléphones portables antiques (les tout premiers, avec des antennes), va renforcer cette sensation de perte de repères spatio-temporels. Le scénario dès lors dévide magistralement son écriture en forme de boustrophédon, folâtre dans le labyrinthe d’une parabole qui oscille entre conte de fées contemporain et réalisme lyrique. Le prénom de Lazzaro semble tout droit sorti de la bible, celui du fils de la marquise, Tancrède, évoque inévitablement Le Guépard, tant et si bien qu’on serait à peine étonné d’entendre l’un déclarer : « Il faut que tout change pour que rien ne change » et de voir l’autre ressusciter. Entre ces deux personnages se tisse une amitié contre nature, entre l’arroseur et l’arrosé, l’exploiteur et l’exploité, tous deux victimes de leurs castes respectives, incapables de s’en émanciper. De la même façon qu’il est dans la nature de Lazzaro d’être un agneau, Tancredi est prédateur de naissance, prisonnier d’une mère dominatrice qui n’hésite pas à maintenir ses employés dans un servage décadent et illicite. Et aussi surréaliste que nous paraitra la situation, elle est issue d’un fait divers bien réel de l’an 1982, point de départ de cette parabole païenne pragmatique, qui regarde notre époque concupiscente sans ciller, tout comme le fait son héros ordinaire Lazzaro.
On ne peut dévoiler ici toutes les trouvailles, gags, percées poétiques de ce troisième film d’Alice Rohrwacher… Il faudra vous laisser porter par la verve généreuse de la réalisatrice qui, à travers cette fable aussi ludique que profonde, nous questionne sur nos Eden perdus mais dont nous portons les germes, nous qui méprisons les plantes comestibles qui poussent sous nos pas au profit de nourritures illusoires. votre commentaire
votre commentaire
-
Un très beau film même s'il est horrible dans ce qui arrive à la jeune fille... C'est très triste. Les acteurs sont formidables.
scénario: 18/20 acteurs: 18/20 technique: 18/20 note finale: 18/20

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.
C’est une chanson qui rôde dans les têtes… « Mon histoire, c’est l’histoire d’un amour… ». Remontent à la surface les souvenirs : « … un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien tout le mal… Avec les soirées d’angoisse et les matins merveilleux »… Une ritournelle qui guide les pas de Rachel et Philippe sur le parquet de leur premier bal, enlacés et émus, oublieux de la foule, tourbillonnant au gré des caprices d’une « flamme qui enflamme sans brûler ». Comme dans le livre de Christine Angot, c’est la voix neutre de Chantal, l’enfant devenue adulte issue de cette union, qui met en scène leur rencontre « inévitable ». Tout ce qui semble alors simple et limpide ne va cesser de se brouiller et on va être projeté bien au-delà d’une amourette classique. Dans son sillage, c’est l’histoire de toute une époque, d’un climat, de la place des femmes, d’une lutte des classes sourde, peu avouable.
Quand Rachel croise Philippe pour la première fois, elle travaille déjà depuis des années à la sécurité sociale. Lui est fils de bourgeois. Il occupe un premier emploi de traducteur après des années d’études, mais avance déjà avec l’aisance de ceux qui surplombent le monde. Premiers baisers délicats, ébats passionnés. Très rapidement Philippe énonce les règles. Il n’a pas l’intention de se marier, pas plus que de rester à Châteauroux. Rachel, elle, se gorge de tout ce qu’il lui fait découvrir, curieuse d’une culture à laquelle elle n’avait jamais eu accès. Elle aime jusqu’à oublier de se protéger. « Il était rentré dans sa vie, elle ne le voyait pas en sortir » constate la voix off… On pressent le drame. Pourtant il n’aura pas lieu. Du moins, pas celui-là, pas celui que l’on croit. Il n’y aura ni pleurs, ni cris, ni guerre déclarée, quand Philippe partira. Il ne laissera à Rachel que de bons souvenirs et un ventre qui ne cesse de gonfler. Naîtra Chantal. Chaque jour Rachel cultivera pour elle l’image d’un père merveilleux, aimant. De loin en loin, elle insistera pour que Philippe vienne voir son enfant, pour qu’il en soit le père, même à distance. Et surtout pour qu’il lui donne son nom…
C’est le portrait avant tout d’une femme surprenante, faussement docile, non violente, aimante, forte sous son éternelle douceur. Un être digne qui avance la tête haute, assumant résolument son statut de fille-mère à une époque où cela était impensable, assumant le fruit d’un amour qu’elle ne reniera jamais. C’est aussi l’histoire d’un jardin d’Eden perdu à jamais, d’une violence faite à une petite fille qui deviendra une écrivaine et fera de ses mots une arme universelle. Il y en eut rarement de plus justes pour parler de la passion fusionnelle qui unit et sépare mères et filles. Car le véritable amour impossible, c’est aussi sans doute celui-là.
C’est fort, c’est beau, ça nous cueille-là où on ne l’attendait pas. C’est de l’Angot, c’est du Corsini ! C’est puissant comme l’était La Belle saison, le précédent film de la réalisatrice. C’est porté par des acteurs inspirés : Virginie Efira est une Rachel tout bonnement sublime, atemporelle. Les actrices qui donnent chair à Chantal à tous les âges de sa vie (elles sont quatre) sont justes et spécialement l'adolescente Estelle Lescure (une véritable révélation !). Quand à Niels Shneider, il porte dans son jeu la touche assassine, celle qui nous fait frémir et nous tient en haleine tout au long du récit. On a beau percevoir le revers cynique et pervers de son personnage, il n’en reste pas moins attirant, il incarne la séduction absolue, celle contre laquelle ni Rachel, ni Chantal ne sont armées pour lui résister. Le serions-nous nous-mêmes ? votre commentaire
votre commentaire
-
Mais quel ennui! C'est ridicule. Quand il n'y a pas de scénario, y a pas de film. Ce "Silvio" interminable, raconté avec des semelles de plomb, est un naufrage.
scénario: 5/20 technique: 15/20 acteurs: 12/20 note finale: 6/20

Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral après la chute du communisme.
Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée d’être vide.Le pays de Dante, Michel Ange, Raphaël, Garibaldi, Pasolini… celui dont les civilisations successives, dont les œuvres artistiques ont rayonné sur toute l'Europe et bien au-delà… est désormais gangréné par la bande de pathétiques bouffons d'extrême-droite du gouvernement Salvini ! Comment en est on arrivé là ? Une partie de la réponse est peut-être dans le film fleuve et choc, foisonnant, ébahissant de Paolo Sorrentino, qui revient sur un personnage clé de la vie politique italienne des dernières décennies : l'ineffable Silvio Berlusconi, celui qui fut un modèle pour Trump, autre magnat de la presse arrivé au pouvoir. Car c'est bien cet entrepreneur en bâtiment, ce magnat des médias passé en politique dans les années 90 qui a considérablement transformé le rapport au pouvoir des Italiens, imposant sa richesse décomplexée et son goût immodéré pour le luxe et les femmes, banalisant le culte de l'argent facile, la corruption et la prostitution déguisée.
Paolo Sorrentino s'était déjà attaqué dans Il Divo, en 2008, à un autre monstre de l'histoire politique italienne, Giulio Andreotti, le dirigeant indéboulonnable de la Démocratie chrétienne, si puissant qu'on l'appela « Divo Giulio », en référence à Jules César.
Sorrentino n'affronte pas tout de suite Berlusconi, qui n’apparaît dans le récit qu'au bout d'une bonne demi-heure. Le film s'ouvre par une séquence absurde où, dans une propriété immense à la pelouse digne d'un green de golf, un mouton est attiré par un salon tout aussi pharaonique où trône une télé XXL qui diffuse non stop un de ces jeux télévisés stupides qui firent la fortune de Berlusconi… avant de tomber raide mort. Tout est déjà posé : le factice, le vulgaire, le non-sens qui caractériseront le personnage. Puis on suit dans un premier temps un jeune entrepreneur ambitieux des Pouilles, prêt à tout pour remonter la chaine des relations et du pouvoir qui le mènera à LUI, celui que l'on ne nomme pas, mais qui fait trembler les ambitieux et frémir de désir les ambitieuses bien qu'IL soit entré dans sa septième décennie. Pour se faire remarquer de LUI, tout est bon : fournir à un politique une jolie fille pour une relation rapide sur un bateau de pêche, ou infiltrer une fête romaine impériale sur les lieux mêmes qu'arpentèrent autrefois les prétoriens, pour y dénicher la préférée du Cavaliere, un mannequin d'origine albanaise qui l'introduira.
Ensuite Sorrentino et son comédien fétiche Toni Servilio (celui-là même qui incarnait Andreotti dans Il Divo) brossent le portrait de Silvio au moment où, désormais dans l'opposition, il tente de récupérer le pouvoir en achetant le vote de sénateurs pour briguer un troisième mandat à la fin des années 2000. C'est l'époque des tristement célèbres soirées bunga-bunga, où de très jeunes femmes – chacune d'elles recevant du Cavaliere un petit pendentif en forme de papillon – se retrouvent par dizaines dans sa propriété pour des fêtes où drogue, champagne et sexe font bon ménage.
Dans ce décor factice, cette propriété où trône un volcan bidon, où un faux temple cambodgien a été commandé par Silvio pour satisfaire son épouse bafouée férue d'Asie, dans le théâtre en toc de ces fêtes démentes – sublimées par la mise en scène exubérante de Sorrentino – tout est vulgaire et pathétique, y compris le masque perpétuellement souriant, tiré par la chirurgie esthétique, de Berlusconi, piteux pantin de commedia dell'arte. Et puis parfois la vérité éclate, comme dans cette scène saisissante où une nymphette à peine adulte, coincée dans la chambre de Berlusconi qui joue la coolitude pour séduire la belle, le renvoie calmement à ce qu'il est : un vieillard qui va vers la mort, que seul l'argent et le pouvoir rendent désirable aux yeux des ambitieux. Mais le mal est fait : Berlusconi a décrédibilisé en deux décennies la politique au sens noble et ouvert aux populistes la voie royale. votre commentaire
votre commentaire
-
Un très beau film sur l'amour. Un amour puissant et chaud en pleine Guerre froide. Mais impossible aussi. C’est le nouveau voyage magnétique auquel invite Pawel Pawlikowski. C’est un éloge de l’épure. Une démonstration de la puissance émotive du minimalisme pour traduire la relation tempétueuse de deux amants. Les deux acteurs, Joanna Kulig et Tomasz Kot, illuminent cette œuvre fascinante.
scénario: 18/20 technique: 18/20 acteurs: 18/20 note finale: 18/20

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.
Cold war, c’est l’histoire d’une impossible liberté dans un pays aimé mais progressivement gangrené par la montée du stalinisme. C’est aussi une véritable fresque amoureuse, et musicale (la musique est quasiment le troisième personnage principal du film), qui démarre à l’âge d’or du rock’n roll pour venir s’évanouir sur la grève des désillusions. Nous sommes dans les années 1950, la Pologne, en ruines, essaie de panser ses blessures et de se relever progressivement de la guerre. Zula est blonde, coquine, magnifique, et elle a un beau brin de voix. Quand Wiktor, qui dirige la meilleure école de musiques traditionnelles du pays, la recrute pour chanter dans les chœurs, il en tombe instantanément amoureux. Un amour qui ne se démentira pas durant les quinze années suivantes, mais qui restera éternellement impossible à vivre. Ils n’ont ni les mêmes ambitions, ni les mêmes codes, pas plus que la même origine socio-culturelle. Pourtant tout cela s’estompe dans leurs ébats, leur passion qui s’enflamme. Mais est-ce suffisant pour les river toute une vie l’un à l’autre ? Alors que Wiktor ne rêve que de fuir en cachette un pays qui lui interdit de jouer la musique qu’il aime (le jazz, symbole culturel de l’ennemi impérialiste américain), Zula, plus pragmatique, balance entre franchir ce pas périlleux ou rester douillettement rivée au pays, à ses racines, à ses véritables chances de réussir dans le système.
Wiktor a pourtant tout prévu, tout organisé, tout payé pour que sa belle passe à l'Ouest avec lui. Ce jour-là, il l’attend à la gare, le cœur battant, guettant désespérément sa renversante silhouette. Ce jour-là, Zula lui pose un cuisant lapin, difficile à digérer, même s'il peut comprendre le joug de la peur qui règne sur leur pays devenu liberticide. Wiktor se retrouve donc exilé, esseulé, partant à la dérive d’une Europe suspicieuse qui subit les conséquences d’une guerre froide silencieuse mais bien réelle. On va le suivre, de Paris à Berlin en passant par quelques autres capitales, plongé dans une vie où seule compte la musique. De piano bar en salle de concert, joueur de jazz émérite, mais dans le fond si peu reconnu. Zula, de son côté, va poursuivre sa carrière au sein de la fameuse troupe Mazurek, donnant des foultitudes de concerts sous surveillance, dans son pays ou un peu partout en Europe, applaudie, célébrée mais jamais libre.
Au fil de leurs pérégrinations, l’un et l’autre se guettent, se rencontrent, se séparent, avec toujours cette impossibilité de voir leurs errances et leurs cœurs enfin apaisés. Toute l’histoire se décline dans des noirs et blancs magistraux, des passages musicaux somptueux. Un régal pour les mélomanes et les esthètes. Un voyage à travers une époque, qui navigue d’ellipse en ellipse pour aboutir à un film envoûtant, d’une grande beauté formelle.
Il n'est pas anecdotique de signaler que les prénoms des protagonistes sont ceux des propres parents du réalisateur et que l'épopée des Zula et Wiktor du film est proche de celle des Wiktor et Zula de la vraie vie. Et le groupe musical folklorique de la fiction est une référence à peine déguisée au chœur Mazowsze, une véritable institution en Pologne, dont les prestations étaient largement diffusées par la radio et la télévision d'état. « C’était la musique officielle du peuple. On ne pouvait pas y échapper. » votre commentaire
votre commentaire
-
Bof. Ce film est maladroit et n'est pas vraiment réussi. On s'ennuie beaucoup malgré quelques scènes amusantes.
scénario: 12/20 technique: 12/20 acteurs: 15/20 note finale: 12/20

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
Tout le monde l’attendait au tournant, prêt à lui tailler un costard en bonne et due forme. La critique cinéphile en particulier et puis aussi, il faut bien se mettre dans le sac, les programmateurs des salles art et essai ; bref, toute une assemblée qui aime bien, entre deux tressages de lauriers à des films turcs de 3h, casser un peu de sucre sur le dos de quelques malheureux réalisateurs, se moquant joyeusement, et parfois avec une plume acerbe, de leurs films. Gilles Lellouche entrait pile poil dans la case : « comédien qui passe à la réalisation et qui va se faire descendre par la critique ». On a toujours eu le sentiment que ses choix d’acteur l’avaient jusqu’alors cantonné un peu systématiquement dans le rôle du pote un peu lourdingue, du beauf un peu macho dans des comédies pas toujours très finaudes (excepté peut-être son interprétation touchante du mari perdu et assassiné dans le Thérèse Desqueyroux de Claude Miller), et donc, en toute logique, on se disait que son passage à la réalisation en solo (il a déjà co-signé 2 films) resterait dans cette veine. Grosse, très grosse erreur d’appréciation. Parce que comme un retour du bâton qu’on était prêt à lever sur son film, voilà que nous nous sommes pris de plein fouet et sans semonce son Grand bain. La claque fut d’autant plus inattendue que nous nous surprîmes à la trouver fort à notre goût, agréable, drôle, tendre et bien ficelée, dotée d’une écriture précise et rythmée, d’une mise en scène vive et intelligente. Rien à voir avec le brouillon maladroit auquel nous nous attendions : on avait sous les yeux un petit bijou efficace et touchant d’humanité, avec ce dosage presque parfait entre franche comédie et fable douce amère à la mélancolie sous-jacente, celle qui vous cueille sans prévenir et vous laisse ce sentiment d’avoir gravé durablement, quelque part dans un coin de rétine, un doux, joyeux et tendre moment de cinéma.
Bertrand est au chômage. Depuis trop longtemps. Il a perdu le goût d’à peu près tout hormis celui des cachetons et trimballe sa carcasse entre la cuisine, le salon et, les soirs où il se sent aventurier, la rue jusqu’à laquelle il ose descendre pour sortir la poubelle. Bref, c’est la grosse déprime. Au détour d’une sortie piscine, il va tomber sur un improbable club de natation synchronisée masculine, rien que ça. Et comme les nageurs en question ont l’air aussi – sinon encore plus – dépressifs que lui et que le groupe cherche des nouvelles recrues, il va sauter le pas et enfiler son slip de bain. Coaché par une ancienne championne qui cache à peine son blues sous des tirades enflammées empruntées à la littérature classique ou des volutes de clope qu’elle distille assise en tailleur sur le plongeoir, le groupe des sirènes est un sacré patchwork : Laurent (Guillaume Canet), en colère contre tout, Marcus (Benoît Pœlvoorde), glandeur majestueux dont l’entreprise est en faillite (forcément), Simon (Jean-Hugues Anglade), rockeur vieillissant qui rêve d’être David Bowie, et Thierry (Philippe Katerine), grand poète devant la lune. Ensemble, ils assument leurs bedaines autant que leurs échecs existentiels, ils révèlent leurs cannes de serin velues autant que leurs blessures intimes. Mais il faut un défi, bien sûr, pour révéler les talents enfouis et pour que la belle équipe se bricole une fraternité à toute épreuve : qu’à cela ne tienne, ce sera le championnat du monde !
On rit un peu, dans l’eau de ce Grand bain, on rit avec ces mecs ultra sensibles prêts à tout pour réussir un joli mouvement de gambettes ou un porté qui ait de la gueule. Avec ces nanas mi-mamans, mi-matons qui vont les dresser pour obtenir le meilleur d’eux. Sans vulgarité (ou presque quand elle sort de la bouche de Leïla Bekhti, entraineuse tétraplégique et sadique), avec une bienveillance sincère pour cette bande de mâles cabossés, Gilles Lellouche réussit le pari d’une fable sociale à la Full Monty (parce que chacun a sa manière est un exclu faute d’avoir su entrer dans le moule : celui du monde du travail, du couple, de la famille, de l’industrie du disque…) qui dépote. votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires