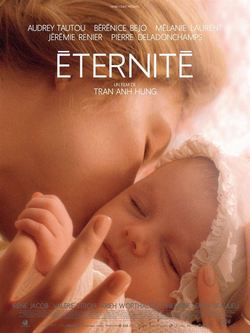-
Intrigué par un film tourné en yiddish, je décidai d'aller voir cette rareté. Ce n'est pas un film, c'est un documentaire sur les pédophiles dans les yéshivas. À l'heure des scandales pédophiles, "M" nous révèle de manière poignante que ce n'est pas l'apanage de certains prêtres catholiques. Si « M » est aussi ahurissant qu’explosif, c’est aussi parce qu’au fil des confidences et des arguments livrés par des religieux - visant à faire reposer tout ceci sur une logique tout à fait explicable, voire excusable -, certains dialogues laissent pantois. En s’attaquant à un sujet tabou dans une communauté orthodoxe, Yolande Zauberman signe un documentaire poignant dont on ne ressort pas indemne.
scénario: 16/20 technique: 16/20 note finale: 16/20

«M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des membres de sa communauté qui l’adulait. Quinze ans après il revient à la recherche des coupables, dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le retour dans un monde qu’il a tant aimé, dans un chemin où la parole se libère… une réconciliation.
C'est la voix de Yolande Zauberman qui nous fait entrer dans son magnifique film : « J’entre dans le monde de mes ancêtres à travers une blessure, celle de Menahem. » Le monde de ses ancêtres ? Celui des hommes en noir, juifs, ultra-orthodoxes, ceux de Bneï Brak, la capitale mondiale des haredim, littéralement les « Craignant-Dieu », plus composite et complexe qu’il n’y parait sous les tenues faussement uniformes. Un monde effarant, qui n’ose pas regarder une femme dévêtue, où chaque moment d’intimité avec ces êtres impurs est calibré, enseveli dans la plus sombre obscurité. On part à la chasse de la moindre miette de lumière, du moindre reflet. On colmate serrures, interstices, fentes… Chacun, avant d’entreprendre sa légitime épouse, se livre à une logistique impressionnante qui prend souvent plus de temps que l’acte lui-même, tuant dans l’œuf la moindre possibilité d’un semblant d’érotisme. D’ailleurs, si on pouvait procréer sans jouir, sans doute le ferait-on, ainsi le veut le Talmud…
Menahem, le M du titre, se souvient de la moiteur des bains, des ablutions entre hommes, soudain troublés, propulsés par un irrépressible tourbillon de sensualité, de désirs inavouables. Il se souvient de ces membres virils, comme aimantés par la chair fraîche, incapables de dominer leurs pulsions… Trop forts pour être repoussés par un petit garçon.
Menahem Lang était alors cet enfant dont la voix cristalline semblait pouvoir élever les plus belles prières vers l’infini. Devenu homme, tout son être paraît vibrer tant il module son chant bouleversant avec maestria. Mais dans les mélodies liturgiques qui le transportent, on perçoit comme une faille vertigineuse où se tapit un monstre vorace. Menahem est un personnage haut en couleur, drôle, extraverti. Pourtant on devine en lui les cicatrices mal refermées. D'abord intimidé, il gagne peu à peu en assurance au contact de Yolande Zauberman. Cet être assoiffé de justice vient réclamer à sa communauté la reconnaissance de sa souffrance, l’obliger à entendre sa vérité d'enfant abusé.
L’homme progressivement nous épate, par sa liberté de ton, par son courage. La réalisatrice par la qualité de son attention, par sa douceur tranchante. L’un et l’autre non violents, malgré la rage rentrée, le venin qui les ronge. L’un et l’autre dignes, admirables. Ne cédant pas à la haine, ne refoulant pas la tendresse qui monte envers cette communauté malgré tout aimée. La caméra pénètre toujours plus profondément dans l'intimité de Menahem, respectueusement, sans la violenter, l'aide à briser les cercles vicieux qui l'entravent, à laver son enfance souillée… votre commentaire
votre commentaire
-
Bien que ce soit remarquablement filmé, ce film est d'un ennui mortel. les acteurs peinent à nous intéresser et eux-mêmes ont l'air de s'ennuyer terriblement. Le scénario est lent et peu intéressant. Les costumes, les décors et la photo sont magnifiques mais cela ne suffit pas.
scénario: 10/20 acteurs: 12/20 technique: 18/20 note finale: 12/20

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.
A l'origine de ce projet singulier, il y a les mémoires de Giacomo Casanova, écrits dans la langue de Molière qui n'était pourtant pas la sienne et découverts par Benoît Jacquot alors qu'il a vingt ans à peine. Cette œuvre le marqua profondément, au point de devenir comme un compagnon secret de sa route artistique, jusqu'à devenir aujourd'hui (enfin ?) la source d'inspiration directe d'un film. Dans ce texte, Casanova évoque avec sincérité sa vie, ses rencontres, ses voyages (l'histoire a retenu le grand séducteur, mais il était avant tout un véritable aventurier) mais Jacquot a décidé de s'attacher à un épisode plus particulièrement marquant : sa rencontre avec une jeune femme, La Charpillon, qui restera son dernier et peut-être son seul et unique amour.
Nous sommes dans les années 1760. Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, doit s'exiler à Londres. L'homme a atteint cet âge de maturité où plus rien ne semble l'effrayer et s’accommode volontiers de cette nouvelle escale dans une ville qu'il connaît peu et dont il ne parle pas la langue. Mais comme tout aventurier qui se respecte, il a dans chaque port quelques connaissances qui vont lui permettre de tenir son rang et le train de vie qui va avec : dîners mondains, bals plus ou moins clandestins et autres parties de jeux de hasard.
Il rencontre ainsi, et à plusieurs reprises, une jeune fille mystérieuse dont il va s'éprendre et qu'il va vouloir conquérir. Mais cette courtisane, dont chacun sait ici qu'elle peut être à tout le monde, va se dérober à chacune de ses avances, distillant dans les jeux complexes de la séduction un venin troublant dont l'homme aux « cent quarante deux conquêtes » (c'est ce qu'il prétend dans ses mémoires) ne va pas sortir indemne. Elle lui lance un défi : elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire. Au nom de sa liberté, de l’idée qu’elle se fait d’elle-même, La Charpillon va décider que cet homme qui les possède toutes ne la possèdera pas, elle. À charge pour lui de comprendre alors que ce qu'elle veut, ce ne sont pas les caresses ni la passion charnelle, mais bien l'essence même de l'amour, un sentiment noble et pur, le seul finalement qui vaille d'être vécu, et que Casanova n'a peut-être jamais encore éprouvé.
Casanova, c'est Vincent Lindon, qui s'est glissé dans le costume avec son charisme animal et porte merveilleusement la lassitude que l'on perçoit dans le visage, dans les yeux de cet éternel voyageur arrivé peut-être au seuil de sa dernière grande épopée. Il a le rugueux du baroudeur et les gestes délicats de l'homme habitué aux salons, aux sonates, aux pas de danse sur des parquets vernis. La Charpillon, c'est la délicieuse Stacy Martin, minois enjôleur qui cache très bien son jeu et dont la silhouette fragile révélera une maturité et une détermination de feu.
Et parce qu'il est un réalisateur qui aime et qui sait magnifiquement filmer les femmes, Benoît Jacquot ajoute sa petite touche personnelle avec un personnage secondaire mais très important dans la construction de sa narration. Cette jeune et jolie femme qui déboule au tout début du film dans le salon sombre où un Casanova vieillissant écrit ce que l'on imagine être cette fameuse Histoire de ma vie et viendra recueillir son témoignage, c'est sans doute un alter ego féminin de Jacquot lui-même… votre commentaire
votre commentaire
-
Après Le Fils de Saul, Oscar du meilleur film étranger en 2015, Laszlo Nemes revient avec un film énigmatique et somptueux, une manière de chef-d’œuvre. Mais le scénario est vraiment embrouillé et on n'y comprend pas grand chose. N'espérez pas y comprendre quelque chose.Et la technique n'est pas à la hauteur: il y a ,souvent des plans flous pas réussis. Mais les costumes et les décors sont somptueux.
scénario: 10/20 technique: 12/20 acteurs: 16/20 note finale: 12/20

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois.
Irisz Leiter revient à Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat.
Son rêve de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau propriétaire.
Lorsqu’Írisz apprend qu'elle a un frère dont elle ne sait rien, elle cherche à clarifier les mystères de son passé.
A la veille de la guerre, cette quête sur ses origines familiales va entraîner Irisz dans les méandres d’un monde au bord du chaos.En 2015, Le Fils de Saul, premier film du jeune Laszlo Nemes, entraînait les spectateurs dans un voyage éprouvant et mémorable, suivant, à l’aide de longs plans-séquences, le parcours d’un prisonnier du camp de concentration d’Auschwitz, des dortoirs crasseux jusqu’aux tranchées servant de charniers. Accueil triomphal à Cannes, Grand Prix du jury conforté quelques mois plus tard par l'Oscar du Meilleur film étranger. De quoi permettre au cinéaste hongrois de se lancer sans difficulté dans un nouveau projet, mais aussi de lui coller une pression phénoménale sur les épaules, car ce second film était forcément attendu au tournant.
Pour Sunset, il opte à peu près pour le même procédé, suivant le personnage principal dans une ville de Budapest labyrinthique, en 1913. Cette fois, il ne filme pas un univers de souffrance et de mort, mais un monde en pleine déliquescence, une société agonisante, brûlant ses derniers feux avant le chaos.
La caméra ne quitte pratiquement pas Irisz Leiter (lumineuse et grave Juli Jakab), qui revient à Budapest après plusieurs années passées hors du pays. Enfant, elle avait été envoyée suivre une formation de modiste. Aujourd’hui adulte, elle souhaite se faire engager dans le magasin de chapeaux que ses parents avaient fondé, et qui a été repris, après leur mort tragique, par leur employé, Oszkar Brill. Mais celui-ci, non seulement refuse de l’engager, mais lui fait comprendre qu’elle n’est pas la bienvenue dans cette ville.
Le même soir, la jeune femme est rudoyée par un homme à la recherche d’un certain Kalman Leiter, qui pourrait être son frère. Intriguée, elle décide de rester à Budapest et de partir elle aussi à sa recherche. Elle découvre rapidement que Kalman est recherché pour le meurtre d’un notable, et considéré comme l’un des chefs de file des anarchistes. Pour le retrouver, elle va devoir s’aventurer dans les bas-fonds de la ville…
Laszlo Nemes veut montrer toutes les facettes de cette ville tumultueuse, qui constitue, au début du xxe siècle, l’un des lieux les plus importants d’Europe. En 1913, l’Empire Austro-Hongrois est en effet à son apogée. Il règne sur une douzaine de pays, rassemblant différents peuples, différentes cultures et les partisans de tous les grands mouvements politiques, de l’extrême-droite à l’extrême gauche, qui vont marquer le vingtième siècle. Cette diversité se retrouve Budapest, mais reléguée dans la marge, sous le regard méprisant des notables locaux et l’indifférence de l’empereur, qui vit coupé du peuple dans son palais viennois.
La mise en scène montre bien le clivage de cette ville, faisant cohabiter la grande bourgeoisie – la clientèle du magasin Leiter – et les groupuscules révolutionnaires, cachés dans les bas-fonds.
Irisz est le trait d’union entre les deux mondes. Mais elle est aussi complètement étrangère à cette société, à cette ville qu’elle a quitté alors qu’elle n’avait que deux ans. Elle les découvre en même temps que le spectateur, qui voit à travers son regard. Elle est à la fois fascinée par cet environnement bouillonnant et perplexe face aux mystères qui entourent la ville. Partout règne une atmosphère de conspiration, de lourds secrets, plus Irisz s’approche de ce qu’elle pense être la vérité, plus le mystère s’épaissit. Et quand elle comprend finalement les conséquences de cette agitation politique, dans les tranchées entre la France et l’Allemagne, il est déjà trop tard.
La mise en scène de Laszlo Nemes, remarquable, accompagne cette prise de conscience progressive, passant de mouvements de caméra élégants, réglés comme des valses viennoises, « nobles » d’un point de vue purement artistique, à des prises de vue plus brutes, plus brusques, évoquant autant le chaos social et politique que le trouble qui gagne peu à peu Irisz, à mesure qu’elle réalise la décadence de l’Empire et la perversité des notables du pays… votre commentaire
votre commentaire
-
Encore un film très réussi. Le duo Camille Cottin/Fabrice Luchini, dont la complicité et la spontanéité se marient à point avec le décor apaisant tout de pierres et de couleurs bretonnes, fait le sel de cette comédie qui, si elle rend hommage aux amoureux des livres et célèbre le pouvoir des mots, reste avant tout un divertissement intelligent.
scénario: 17/20 technique: 17/20 acteurs: 17/20 note finale: 17/20

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.
Quand vous êtes un jeune auteur, que vous avez passé des années à peaufiner votre manuscrit et que, alléluia, il est publié par un gros ou petit éditeur, pensez-vous que les choses soient terminées ? Non. Il faut passer l'épreuve de la critique, et plus particulièrement affronter les jugements péremptoires de Jean-Michel Rouche, chroniqueur télé à succès qui taille des costards ou encense les nouveaux romans publiés. Autant dire que si vous espérez un succès de librairie, il vaut mieux que Jean-Mi ait aimé votre bouquin.
Pendant qu'à Paris il prépare sa prochaine émission – et qu'accessoirement il comprend que sa femme est en train de le quitter –, dans un petit village de Bretagne, une jeune éditrice au sourire enfantin mais aux dents un peu pointues tombe sur une bien étrange bibliothèque, dite « des manuscrits non publiés ». Elle y découvre ce qui lui paraît être une pépite, Les Dernières heures d'une histoire d'amour, qui mêle l'agonie d'une passion amoureuse et celle de Pouchkine, le grand poète et dramaturge russe. Elle pressent qu'elle tient là un gros succès et en effet, bingo ! Dès sa publication, le livre fait un carton. On salue unanimement l'intelligence, le brio de l'écriture autant que la prouesse littéraire de mêler deux tragiques destinées dans un style qui est celui des plus grands… Il y a en outre un mystère autour de l'auteur de ce chef d'œuvre impromptu : le roman est signé Henri Pick, décédé deux ans auparavant et connu uniquement comme le propriétaire de la pizzeria du petit village à la fameuse bibliothèque. Énigme supplémentaire : selon sa femme, Henri, un homme discret et on ne peut plus simple, n'a jamais lu un livre ni écrit une ligne de sa vie, pas même le menu sur l'ardoise de son restaurant…
Bref, c'est typiquement le genre de buzz dont le petit milieu est friand et l'affaire commence à faire naître les plus folles rumeurs sur le cas Henri Picq : l'histoire de la littérature regorge d'exemples où de grands auteurs se sont cachés derrière un pseudo et il y a bien des maîtres du genre qui ont vécu d'autres vies que la leur pour écrire en secret…
Pour Jean-Michel Rouche, sceptique par principe, l'histoire ne tient pas la route et il est persuadé que le prétendu mystère n'est qu'une vaste imposture pour faire vendre. Il décide alors de partir en Bretagne pour mener l'enquête et lever le voile sur cette mystification, plus ou moins secondé par Joséphine, la fille de l’énigmatique Henri Pick.
Alors la voilà l'équation, simple et efficace comme un best seller qu'on lit d'une traite : Luchini + Foenkinos, ça donne une comédie façon enquête littéraire furieusement efficace et pétillante. votre commentaire
votre commentaire
-
Ce film est génial!!! On rit d'un bout à l'autre. Les actrices sont géniales. Le scénario est top. Une BO impeccable et des vues flatteuses de Boulogne-sur-Mer et du Portel achèvent de nous rendre furieusement sympathique cette comédie drôle et délurée, crue et culottée.
scénario: 18/20 acteurs: 18/20 technique: 18/20 note finale: 18/20

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...
Si vous n’aimez que les choses délicates, les œuvres raffinées, le bon goût, les bons mots… Si vous avez frémi au phrasé exquis et subtil de Cécile de France dans Mademoiselle de Joncquières et si la soie, le velours, le satin apportent à votre quotidien toute la douceur et la délicatesse dont vous avez besoin pour vous épanouir… et bien, n’achetez pas de place pour venir voir Rebelles. Vous risqueriez d’être furieusement en colère contre moi (dans le meilleur des cas), voire de subir un choc cinématographique aigu, et chacun sait qu’un CCA peut être au moins aussi grave qu’un anaphylactique. Car de dentelles, de rubans fleuris, d’alexandrins, dans ce film, il n’y en a point. Alors quoi ? On a retourné notre veste en tweed à Utopia ? On aime le gros rouge qui tache quand vous aviez toujours cru que nous ne jurions que par les vins bio naturels sans sulfites ni phosphates, élevés en cuve centenaire au clair de (pleine) lune ? Non, pas du tout.
On a beau aimer le cinéma haut perché, défendre les Auteurs et les œuvres complexes, nous avons toujours été assez friands (peut-être pas la majorité de nos troupes, mais quand même) de ce cinéma irrévérencieux et mal poli qui flirte parfois avec le mauvais goût mais parvient à nous rendre sympathiques les pires sans foi ni loi, parce qu’ils sont toujours du côté des oubliés, des petites gens, des besogneux, et que leurs aventures, même répréhensibles, ont toujours le goût de la revanche sur les injustices de la vie, ses dominations, qu’elles soient sociales ou de genre.
Nous sommes avec Rebelles bien plus dans un esprit Groland, ou celui des premiers films d’Albert Dupontel que du côté de Ken Loach et ça décoiffe sévère, à grands coups de truelle. C’est assez jubilatoire, souvent très drôle, et c’est enlevé par un trio féminin pétaradant qui vaut à lui seul le détour et fonctionne à plein régime, façon feu d’artifice. Alors oui, bien sûr, ça tache un peu, et non, ce n’est pas la grande classe, mais si vous acceptez de mettre votre bon goût légendaire (vous venez chez nous quand même et ça, c’est un signe qui ne trompe pas) de côté, l’effet poilade est garanti.
Quand elle débarque du Sud de la France, sa valise en carton au bout de ses ongles impeccablement manucurés, en faisant la tronche parce qu’obligée de retourner vivre chez maman dans ses Hauts de France natals, Sandra ne se doute pas encore qu’elle va bientôt devenir riche, très riche. Elle ne connaît pas non plus celles qui deviendront ses deux complices à la vie, à la mort : Nadine, flegmatique ouvrière qui entretient un mari paresseux mais qui cache sous son tablier le costume d’une Bonnie Parker, et Marilyn, mère célibataire punk et survoltée, prête à dézinguer la terre entière pour une bonne cuite. Il sera question de boîtes de conserves, en très grande quantité, de la bande des Belges avec lesquels il vaut mieux ne pas trop faire les marioles, et d’un sac bourré de biftons, « le début des emmerdes », comme dirait Nadine, clown blanc de la bande, la plus ancrée dans le réel, la plus lucide.
Allan Mauduit filme la conserverie de poisson, les docks de Boulogne-sur-Mer ou le camping en hiver comme s’il s’agissait d’un décor de western, sans méchanceté gratuite, avec un sens du comique de situation explosif, et il nous rend ses trois héroïnes, quoiqu’immorales, cogneuses, hargneuses… très attachantes car symboles d’un Girl Power décoiffant. Plus jamais vous ne regarderez une boîte de thon du même œil, ni une porte de vestiaire… on en recause. votre commentaire
votre commentaire
-
Du pur navet! Blier fait toujours des films bizarres mais quand en plus c'est nul... On comprend mieux pourquoi le réalisateur ne voulait pas montrer son navet aux journalistes... Les acteurs font ce qu'ils peuvent mais avec un tel scénario, c'est difficile pour eux. Mais c'est bien filmé bien que d'un ennui mortel. "Convoi exceptionnel" prouve une fois de plus que le petit univers de Bertrand Blier est devenu totalement étanche à quoi que ce soit qui pourrait le connecter à autre chose qu’à lui-même.
scénario: 2/20 acteurs: 5/20 technique: 16/20 note finale: 2/20

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…
 votre commentaire
votre commentaire
-
Un film surprenant qui va de surprises en surprises. C'est très réussi. les acteurs sont au service d'un scénairo particulièrement intéressant. Le nouveau film de Safy Nebbou est aussi joueur qu’aigu. Ce portrait de femme borderline lui permet d’explorer finement les dérives de notre époque schizophrène, constamment tiraillée entre son goût pressant pour la transparence et ses petits arrangements avec la vérité. A travers ce portrait de femme complexe auquel Juliette Binoche se donne toute entière, Safy Nebbou livre un numéro cinématographique de haute voltige.
scénario: 18/20 acteurs: 17/20 technique: 17/20 note finale: 17/20

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.
Elles en ont fait, du chemin, les nanas, depuis les soutifs brûlés… Conquérir des postes de pouvoir, refuser la domination masculine, choisir d’avoir (ou pas) des enfants, les faire seules et tenter d’être avec talent sur tous les fronts : au boulot, au lit, à la sortie de l’école, devant les fourneaux, et dans les dîners mondains. Elles se sont libérées, sans doute, et c’est tant mieux. Pourtant une autre forme d’aliénation s’est insidieusement glissée dans les cerveaux, sournoise, pernicieuse, d’autant plus difficile à combattre qu’elle est le fruit d’une injonction intime, nourrie par l’air du temps, distillée par les revues, la mode, sur un ton souvent enjôleur comme si tout cela n’était pas si grave. Il faut être désirable, en forme et garder les siennes bien fermes, être comme si le temps n’avait pas de prise, ni les grossesses, ni la fatigue, ni les coups durs de l’existence.
Claire tente de composer avec tout ça et ne s’en sort finalement pas si mal. Larguée par l’homme de sa vie, elle vit seule depuis maintenant suffisamment longtemps pour supporter la déception d’avoir été trahie et jongle entre son boulot de maître de conférence, sa vie de mère et une relation exclusivement sensuelle avec un homme bien plus jeune qu’elle. Elle a beau se dire intérieurement qu’elle pourrait être sa mère, qu’elle n’a plus forcément tous les atouts pour garder contre son corps de femme de cinquante ans ce beau gosse musclé et plein de fougue, elle fait comme si le temps pouvait suspendre son vol, ne gardant que le meilleur sans les remords.
Mais jeunesse se lasse… et Claire se retrouve sur la touche, non pas bannie, mais simplement écartée, comme un beau joujou auquel l’enfant aurait fini de s’intéresser, parce que la vitrine propose bien d’autres choses plus alléchantes.
Comme Claire vit avec son temps et qu’elle n’est pas la dernière des cruches pour surfer dans ce vaste monde parallèle que sont les réseaux sociaux, elle va s’inventer un double pour espionner son amant négligent par l’intermédiaire de son meilleur pote, photographe de son état.
Elle va devenir Clara, jeune, forcément très jolie et pas conne.
Devenir autre est d’une facilité déconcertante et la proie va mordre à l’hameçon… tellement bien qu’une relation virtuelle entre les deux (presque) jeunes gens va s’installer. Prise à son propre jeu, Claire va jouir de ce nouveau statut, grisée par le mirage d’être redevenue jeune, désirable, attirante, fusse au prix du mensonge, de la manipulation et des faux semblants.
Tout cela va mal se terminer, bien sûr, car on ne peut pas être celle que vous croyez sans se perdre dans les jeux de miroirs, sans troubler les eaux de sa propre identité pour finalement se noyer dans un océan virtuel qui cache sous ses allures de carte postale idyllique les méandres d’un gouffre digne du triangle des Bermudes.
De forme initialement assez classique, le film n’est pas tout à fait non plus celui que l’on croit, plus malin, plus retors et plus complexe qui n’y paraît de prime abord. Banal portrait d’une femme mûre comme on dit pudiquement (sauf que bon, quand même, c’est Juliette Binoche et elle est canon), le récit se mue doucement en thriller au cœur duquel le spectateur lui-même va être aspiré, sans trop savoir finalement de quelle réalité il est ici question. Celle de Claire maître de conférence qui veut être aimée pour ce qu’elle est ? Celle de Claire racontant son histoire machiavélique dans le bureau d’une psychiatre (Nicole Garcia, impec) ou celle de Claire qui écrit son histoire pour exorciser ses démons ? votre commentaire
votre commentaire
-
Encore une merveille! On reste en haleine jusqu'au bout. "Les Témoins de Lendsdorf" nous rappelle qu’un film, quand il est réussi, est toujours symbolique, qu’il réunit l’image et l’idée, que l’une ne va jamais sans l’autre. Dans les champs ou les salles d’archives, l’investigation en question relève de l’archéologie mémorielle... Mais on est littéralement happé par ce travail austère et dérangeant, d’autant que l’obsessionnelle enquête de Yoel bifurque vers un questionnement identitaire assez inattendu. Et vertigineux. Amichai Greenberg, dont c'est le premier long métrage, fait preuve d'une grande efficacité narrative et d'un vrai sens du rythme. Sa mise en scène séduit, tandis que la complexité de son propos satisfait les cinéphiles les plus exigeants. Le réalisateur israélien Amichai Greenberg adopte la forme du thriller pour mettre en lumière le massacre de Rechnitz, en Autriche, en 1945 et les questionnements d’un historien sur son identité juive. Et c'est une totale réussite.
scénario: 18/20 acteurs: 18/20 technique: 18/20 note finale: 18/20

Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en Autriche, au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale. Jusqu’ici patientes et monacales, ses recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le site sera bétonné sous quinzaine…
Le propre de l'homme, c'est l'oubli…
Yael est un historien juif orthodoxe qui enquête depuis des années sur une question qui l'obsède : où donc sont enfouies les victimes d'un massacre de Juifs qui a eu lieu à la fin de la seconde guerre mondiale à Lendsdorf, au cœur de l'Autriche ? Ses recherches jusqu'alors solitaires et silencieuses prennent brutalement un coup d'accélérateur à cause de l'ultimatum donné par les responsables d'un projet immobilier qui doit s'implanter sur ce qu'il suppose être l'endroit où sont enterrées les victimes : impossible de geler indéfiniment toute construction. Faute de preuves tangibles du massacre, le site sera bétonné sous quinze jours.
Yael s'immerge alors plus intensément dans les archives, se rend sur les lieux supposés du carnage, s'acharne à retrouver les témoins encore vivants, les presse de questions… C'est comme un thriller, la quête obsessionnelle et tourmentée d'une vérité qui se dérobe sans cesse : il y a ceux qui ont oublié, ceux qui veulent oublier, ceux qui se taisent et Yael se cogne contre le vide du silence tandis que cette histoire qu'il n'a pas vécue l'affecte au plus profond de lui même, comme s'il avait absolument besoin de savoir pour pouvoir vivre sereinement. « La question de la Shoah est un élément intense et lourd de la vie de la communauté juive , dit Amichaï Greenberg, même aujourd'hui… » Comment et pourquoi cette nécessité de transmettre la mémoire de la Shoah alors même qu'on ne l'a pas vécue ? L'histoire de ceux qui nous ont précédé a-t-elle un si grand rôle sur ce que nous sommes…
Cette quête que Yael menait, croyait-il, avec des motivations religieuses, culturelles, idéologiques, va pourtant prendre un tour inattendu en le confrontant à l'histoire de sa propre famille, une histoire occultée par sa mère et qui le renvoie tout à coup à sa propre identité. La vérité est-elle toujours bonne à dire, en quoi nous aide-t-elle à vivre ? Cette mise à nu d'une histoire familiale enfouie va avoir des conséquences dans sa relation à ses proches, à son neveu à particulier… L'oubli serait-il parfois un remède à la douleur et le silence une nécessité pour arriver à survivre ? Le véritable mystère qui alimente alors l'intrigue semble être moins celui du lieu où sont enfouis les disparus que les mensonges de sa propre mère.
The Testament (traduction anglaise du titre original) est inspiré du massacre de Rechnitz en Autriche. Dans ce petit village, 600 Juifs sont condamnés à des travaux forcés. Dans la nuit du 24 au 25 août 1945, peu de temps avant l'arrivée de l'Armée Rouge, une grande fête à laquelle participe la nomenklatura nazie est donnée dans un château voisin du camp des prisonniers. Pendant que la fête bat son plein, les officiers allemands distribuent des armes aux invités qui massacrent alors près de 200 Juifs.
Ce ne fut pas un cas isolé dans la région, où on achevait les prisonniers trop épuisés pour marcher. Mais dans ce cas précis, on ne retrouvera jamais les corps des victimes, les habitants de Rechnitz s'enfermant dans un mutisme obstiné, scellé au fil du temps par la disparition des témoins. votre commentaire
votre commentaire
-
Un film plein d'humour avec des acteurs formidables! On rit d'un bout à l'autre. Les dialogues sont géniaux. Une réflexion brillante sur le pouvoir de l’argent.On peut simplement regretter que la fin ne soit pas à la hauteur du film.
scénario: 18/20 acteurs: 18/20 technique: 18/20 note finale: 18/20

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires roublard. Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, La Chute de l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand.
Nous faire pouffer de rire sur ce monde désespérant ! C’est une fois de plus le pari réussi par Denys Arcand. Le constat est tout aussi sévère que dans les précédents films de la trilogie officieuse entamée avec Le Déclin de l’empire américain (1986) et Les Invasions barbares (2003). S'il n’est nul besoin d’avoir vu les deux premiers pour apprécier ce nouvel opus, les spectateurs qui les connaissent retrouveront la même veine narquoise sous une forme entièrement renouvelée, qui pioche dans le registre de la comédie et du film noir pour en illustrer le propos de façon toujours plus percutante et dynamique. Un film somme, où l’on retrouve les thèmes de prédilection du réalisateur et son sens du dialogue mis au service de ce qu’il sait faire de mieux : s’en prendre au système.
L’empire américain décidément dégringole de haut. Bien mal avisés sont ceux qui continuent de penser « Jusqu’ici tout va bien ! » alors qu’il les entraîne avec lui dans sa course folle et que le sol se rapproche inexorablement ! Ce n’est pas en faisant l’autruche qu’on apprend à voler ! Alors mes biens chers sœurs, mes bien chères frères, rigolons ensemble ! Ça au moins, on ne peut pas nous le retirer.
Pierre-Paul (tiens, il manque Jacques ?) est un spécimen en voie de disparition, un idéaliste de première dans une époque décadente. Il a des airs de troglodyte mal luné malgré son jeune âge. C’est pourtant une tronche, ce gars-là. Des années d’études brillantes pour obtenir un doctorat en philosophie et le voici enfin devenu… chauffeur livreur ! Le même alphabet qui lui permettait de lire Marx, Épicure, Aristote ou Racine… ne lui sert plus qu'à rentrer des adresses sur son GPS. On serait aigri à moins… Quant à ses amours, elles battent de l’aile. Sa copine bosse dans une banque, ce qui fait d’elle une collabo, une social-traitre. Bon, Pierre-Paul est poli et cultivé, il le lui dit donc de façon plus élaborée, mais non moins blessante… Et son amoureuse de lui demander à juste titre : m’aimes-tu donc ? Et lui de ne savoir que répondre. Y’a pas mieux pour briser une relation pourtant sincère.
Sur ces entrefaites, un événement vient bousculer le cours des choses et l’empêcher irrémédiablement de retrouver ses esprits. Une manne inespérée va lui tomber du ciel, ou plutôt d’un camion : alors qu’il doit livrer un stupide colis pour trois dollars six cents, Pierre-Paul se retrouve à la tête d’un jackpot incroyable qui va tournebouler sa vie et pas que la sienne ! Mais chut ! On ne va pas tout vous dire, n’est-ce pas ? Voilà en tout cas notre olibrius dans une situation inextricable qu’il ne peut résoudre seul. Dès lors il devra entraîner dans son son sillage de drôles de zigotos : une prostituée de luxe, un gangster sur le retour, un avocat d’affaires, un kiné asiatique, un voleur à la tire noir et, tant qu’y être, sa désormais « ex », la banquière. Tout un aréopage improbable, des bras cassés unis pour réussir le coup du siècle ! Tandis que la police, rongeant son frein, lui colle aux fesses, Pierre-Paul (toujours sans Jacques !) louvoie entre ses activités salariées et bénévoles pour l’équivalent québecois des « compagnons d’Emmaüs ». L’occasion de faire un arrêt image sur ces beaux portraits de SDF, femmes, hommes, natifs d’ici ou d’ailleurs. Notre damoiseau a le cœur aussi grand que tous ceux qui luttent avec ou sans culottes, avec gilets jaunes ou sans chemises. Un cœur plus généreux que les possédants, les dirigeants… Dans le fond, l’injustice et la misère seront toujours plus puantes que l’odeur de l’argent sale, nous dit cette parabole contemporaine grinçante, haute en cynisme, mais fichtrement drôle. votre commentaire
votre commentaire
-
Des décors en carton-pâte, un scénario minimaliste embrouillé, des dialogues insipides: c'est ça le gros film de la semaine. C'est nul, ça n'apporte rien et c'est une perte de temps. Le nouveau blockbuster Disney-Marvel peine à relever le challenge « Wonder Woman ». Une héroïne monolithique dont le combat féministe semble être la seule raison d’exister. Le résultat, sans émotion, est plus proche de la niaiserie d’Un raccourci dans le temps que d’un Avenger traditionnel.
scénario: 3/20 acteurs: 3/20 technique: 3/20 note finale: 3/20

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Un très beau film tout en nuances. Melvil Poupaud, Denis Ménochet et Swann Arlaud interprètent avec superbe ces héros ordinaires qui brisent le silence. Un film engagé et brillant. A travers un fait d’actualité, François Ozon signe à la fois un grand film politique, incitant à de grands questionnements de société, et un portrait très juste d’hommes fragiles mais jamais faibles.
scénario: 18/20 acteurs: 18/20 technique: 18/20 note finale: 18/20

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.Ne rien laisser au hasard, ne rien céder au pathos. Refuser le manichéisme autant que les raccourcis, ne pas tomber dans la caricature, fuir les clichés. Frapper fort, mais avec une implacable justesse, sans appel, sans échappatoire, sans possibilité aucune ni de minimiser, ni de tergiverser : voilà la chair, puissante, du nouveau film de François Ozon. Et c’est un grand film, un film important. Il faut par ailleurs une audace certaine pour se lancer dans une fiction inspirée de faits on ne peut plus réels, en ne changeant ni les noms des protagonistes, ni les dates, ni les lieux, ni les témoignages. Grâce à Dieu aborde donc de front les actes criminels de pédophilie commis au sein de l’évêché de Lyon par le Père Preynat dans les années 1980 et 1990, et met en évidence le silence complice de l’Église et en particulier celui de Monseigneur Philippe Barbarin, archevêque de Lyon depuis 2002. Redisons le mot : le résultat à l'écran est implacable.
Le film commence aux côtés d'Alexandre. Il a la quarantaine, vit à Lyon avec sa femme et ses cinq enfants. C’est une famille bourgeoise, catholique pratiquante, attachée à ses valeurs, unie, aimante, se rendant avec conviction à la messe du dimanche. Un jour, par hasard, Alexandre découvre que le prêtre qui a abusé de lui lorsqu’il était jeune scout officie toujours auprès d’enfants. Choqué, mais aussi porté par les paroles du nouveau pape progressiste, François, il décide de s’adresser aux autorités ecclésiastiques pour demander des explications. Sans le savoir, il vient d’ouvrir la boîte de Pandore, qui renferme, outre les monstruosités d’un homme qui a abusé pendant des années de dizaines de jeunes garçons placés sous son autorité, toute la mécanique du silence qui a insidieusement été mise en place par la hiérarchie de l'Église, par les familles, par la société.
Face au manque évident de réactivité de l’Évêché, parce qu’il croit sincèrement à la vertu de la parole et qu’il demeure viscéralement attaché aux valeurs chrétiennes, Alexandre va aller plus loin et chercher d’autres témoignages. Un, puis un autre, et un troisième lui parviennent : parmi les anciens scouts du groupe Saint-Luc, nombreux sont ceux à avoir subi les attouchements, et parfois plus, du père Preynat, homme d’Eglise charismatique et terrible prédateur sexuel.
Le film s’attache alors à raconter la création, dans un élan où fraternité et douleur se rassemblent, de l’association « La parole libérée » : en portant l’affaire sur la place publique, en demandant des comptes à l’église sur son silence, en voulant que justice soit faite, les victimes vont faire céder le verrou qui a cadenassé des décennies de honte, relâchant dans les esprits les torrent de souffrance qui, enfin, va pouvoir être dite et entendue. Et l’image, symbolique, de ces adultes accompagnant les enfants trahis qu’ils étaient dans ce délicat cheminement est tout simplement bouleversante.
Alexandre s’est construit tant bien que mal une identité avec ce fardeau, trouvant le salut dans l’amour d’une famille et dans la foi. Mais Gilles n’a jamais pu s’extirper de la peur, de la culpabilité, ni en finir avec cette rage sourde qui distille encore en lui tant de violence. François, de son côté, a enfoui le secret dans un recoin bien planqué de sa mémoire, bouffant du curé comme on prend un antidote au poison. Certaines familles ont essayé de protester et ont renoncé devant l'impossibilité de se faire entendre, d'autres ont su et se sont tues, d’autres ont détourné le regard, d’autres encore ont minimisé les faits…
Porté par un trio de comédiens remarquables, Grâce à dieu a l’intelligence de placer au centre de son propos la dimension humaine et la question du droit, de la justice, sans éluder les questions spirituelles et morales que le sujet implique. votre commentaire
votre commentaire
-
On rit d'un bout à l'autre. Les acteurs sont formidable e les dialogues plein d'humour. Une comédie sociale portée par deux acteurs au top. Mohamed Hamidi se joue des clichés et signe un film énergique - prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez - qui fait du bien, avec un Gilles Lellouche attachant en PDG stressé.
scénario: 17/20 acteurs: 17/20 technique: 17/20 note finale: 17/20

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires